La clinique et la psychopathologie contemporaine de l’adolescent tentent de décrire une période de développement récapitulant les étapes antérieures et sensée aboutir à la maturité adulte. A ce titre, nombreux sont les spécialistes de l’adolescent, tels que Male, Jeammet et Racamier, qui décrivent la complexité du lien avec l’adolescent. Il s’agit en effet, d’une exignce de travail psychique conflictuel, sinon paradoxal, d’intégration de contraintes multiples. Cependant, en comparaison aux travaux sur la psychothérapie de l’enfant et de l’adulte, la psychothérapie de l’adolescent manque aujourd’hui de validation.
Autant dire qu’un voile épais entoure cette période de la vie de l’être humain de sorte que d’aucuns n’hésitent pas à lui attribuer toutes sortes de significations. Aussi, entend-on souvent les parents justifier les symptômes de leurs enfants par la crise d’adolescence. Plus grave, on en vient à banaliser la souffrance de ces êtres en devenir à peine sortis de l’enfance. Pour illustrer ces propos, citons ces paroles d’une mère qui me dit en prenant rendez vous “ma fille a tenté de se suicider, mais ce n’est pas grave n’est ce pas? C’est l’adolescnce.” Comme si à cette période de la vie, il était tout à fait naturel d’attenter à sa vie.
Pour traiter du sujet, je me propose d’aborder la question du transfert, et pour ce faire, j’ai repris au compte de l’adolescent, le débat qui a opposé mélanie Klein à Anna Freud au sujet de l’enfant. Pour Mélanie Klein, l’interprétation doit exclure toute influence pédagogique, le symptôme s’insérant dans la situation analytique. En revanche, Anna Freud considère que l’analyse des enfants poursuit un but éducatif à côté du but analytique, elle rattache ce but éducatif à la formation du surmoi en lien à l’objet aimé. Il s’agit avant tout « d’une protection » pour l’enfant, à la suite de la levée du refoulement, l’empêchant d’aller vers la satisfaction immédiate de ses pulsions, alors même que son Moi n’est pas tout à fait renforcé. Elle préconise donc d’établir d’abord un lien affectif solide avec l’enfant qui constitue la préparation au travail que l’on veut faire avec lui.
Mais que peut-on entendre par “établir un lien solide”? Et qu’en est-il de l’adolescent ?
Il n’a pas échappé aux thérapeutes qui ont travaillé avec les adolescent que la relation semble toujours vacillante, d’autant plus que l’adolescent, conscient des changements liés à la maturation sexuelle, commence à prendre ses distances avec les adultes, sans pour autant parvenir à se replier sur son Moi, encore fragile. La difficulté principale est donc liée au fait qu’a l’adolescence, l’objet externe est aussi menacant que l’objet interne.
Si en clinique infantile, nous impliquons souvent le parent, en donnant en quelques sortes des orientations majeures qui visent à rétablir l’équilibre et à agir sur la réalité externe; Et si en clinique adulte, un sujet qui s’engage dans une cure, est considéré comme ayant un encrage suffisamment solide dans la réalité qui lui permet de supporter les mouvements régressifs, alors qu’en est-il du sujet adolescent qui cherche a acquérir son autonomie, voire même qui la revendique? Comment penser la relation transférentielle avec l’adolescent en prenant en compte ses fragilités narcissiques? Comment ménager les défenses et éviter le mouvement régressif caractéristique de la cure qui pourraient lieu lieu aux passages à l’acte ?
L'adolescence, c’est surtout une période critique
L’adolescent est rendu vulnérable par les modifications physiques et psychiques de la puberté qui sexualisent les conflits. Il est alors poussé à établir une distance affective et à aller vers une plus grande autonomie et de ce fait, se trouve pour la première fois confronté à la solidité de son Moi et de ses capacités psychiques internes. Son corps devenu mature amène forcément une possibilité de réalisation pulsionnelle mais aussi et dans le même temps, une mise à distance avec les parents. Cette mise à distance se fera d’autant plus par des moyens physiques que l’appareil psychique de l’adolescent est inefficace.
Tous les adolescents ne connaissent pas de “crise”...
Les adolescents qui arrivent en consultation sont des adolescents dont la réalité externe est perturnée. Les parents qui les accompagnent parlent de difficultés scolaires, problèmes familiaux et relations conflictuelles ou difficultés de séparation.
Il est donc important de distinguer chez l’adolescent ce qui est de l’ordre des processus psychiques entravés et ce qui est de l’ordre d’une menace de structuration psychopathologique. Mais si les confusions pesistent c’est parce que de nombreuses analogies ont été établies entre “le fonctionnement adolescent” et ce que nous appelons “le fonctionnement limite”, à savoir :
– une faiblesse du Moi et une grande instabilité affective
– un sens de la réalité parfois altéré (clivage, dénégation, etc…) – une fonction réflexive peu développée, parfois absente
– des relations d’objet partielles
Quoiqu’il en soit, nous sommes portés à croire qu’en cette remise en question amenée par la crise juvénile, il y a également la « chance » de rompre avec une enfance parfois difficile et à échapper à la fatalité de la répétition.
La psychothérapie des adolescents : quelques repères cliniques
La souffrance des adolescents s’exprime souvent par le biais des parents et plus rarement, ou alors de manière peu élaborée, par l’adolescent lui même.
Un important travail d’élaboration de la demande est à entreprendre avant d’envisager une psychothérapie, pour aider l’adolescent à reconnaitre sa souffrance et à formuler une demande. Ce premier temps permet également au thérapeute d’établir précisément les capacités de l’adolescent à :
– établir une communication dans le cadre d’une relation interpersonnelle ;
– identifier ses capacités à s’intéresser à lui même, voire à son monde interne; – repérer sa capacité à affronter les conflits.
L’adolescence, c’est donc cette période où l’écart entre les deux axes fondamentaux de la personnalité « l’axe objectal » et l’axe narcissique » est le plus grand, à cause des remaniements imposés par la puberté. C’est dans ce contexte que s’énonce le paradoxe de l’adolescent : c’est à dire un grand besoin de l’objet mais qui constitue en même temps une menace pour le narcissisme. L’objet externe est pour lui d’autant plus dangereux que le replis sur ses objets internes est déjà une source d’excitation difficile à supporter.
On comprendra alors que la relation transférentielle ne peut pas avoir la valeur classique expérimentée, mais qu’elle n’en demeure pas moins le levier essentiel du traitement.
Qu’est ce qui fait alors la particularité de cette relation? Ce sont les spécificité des défenses ou ce que l’on pourrait appeler les résistances au transfert :
– Défense par le transfert. Elle est d’autant plus amplifiée que les attentes de l’adolescent vis à vis de cet adulte, qui lui offre écoute et soutien, est grande. Le risque encouru est ici que l’ampleur de cet engagement narcissique empêche toute activité de remémoration.
– Défense par l’agir. Elle correspond surtout à une maitrise par l’acte. La multiplication des passages à l’acte a pour fonction d’obliger le thérapeute à intervenir activement en posant des limites. Elle a également pour effet, de mobiliser les parents, les amenant parfois à disqualifier le travail du thérapeute.
Ces deux modalités défensives ont de commun un recours aux mécanismes d’emprise aux détriment d’une relation objectale nuancée. Et on comprend bien que le rôle de la réalité externe est de rendre « narcissiquement tolérable » les investissements objectaux.
A cet âge, plus qu’à un autre, tout objet investi, à savoir le thérapeute, risque de devenir un objet d’excitation pour l’adolescent et de ne plus pouvoir devenir un appui narcissique.
Comment intervenir au près de l’adolescent ?
Il découle de ce qui vient d’être avancé que le travail sur les limites et la différenciation est primordial avec l’adolescent, différenciation entre dedans et dehors mais également entre les différentes représentations qui constituent son monde psychique interne.
La difficulté réside dans le fait de satisfaire les besoins de dépendance sans renforcer ou créer une dépendance au thérapeute. Le thérapeute est donc amené à rendre la relation tolérable en réactivant les processus introjectifs sans susciter la mise en place des défenses anti-objectales. Comme chez l’enfant, la levée du refoulement peut amener à un excès de jouissance et à des mouvements de satisfaction pulsionnelle. Or, chez l’adolescent, qui acquiert une plus grande autonomie, le recours à l’acte, en l’absence d’un ancrage assez solide dans la réalité peut constituer une difficulté supplémentaire et un risque pour lui.
Ces données cliniques vont dans le sens des préconisations d’Anna Freud. Il s’agit d’une expérience émotionnelle réparatrice, une nouvelle réalité, naissant dans le cadre de l’idéal du Moi. Parce que les besoins d’identification de l’adolescent sont souvent multiples et d’aspects changeant, l’adolescent est souvent à la recherche de consignes et de nouvelles formes d’existence empruntées aux adultes.
En guise de conclusion, je dirai donc que les interventions actives “prudentes”, parfois pédagogiques pourraient s’avérer être nécessaires pour les besoins de la maturation de la personnalité, sans forcément rentrer en contradiction avec la démarche thérapeutique. L’interprétation des conflits permettra alors l’utilisation de gratification et parfois même des positions directives prudentes. En somme, ces interventions actives, pourraient se penser dans un double mouvement qui serait “permettre et défendre, délier et rattacher”.
Bibliographie :
Freud, A. (1927). Le moi et les mécanismes de défense. Paris. PUF. 1974.
Freud, S (1905). Trois essais sur la théorie de la sexualité. Paris. Gallimard. 1966.
Jeammet, P. Réalité externe et réalité interne; importance et spécificité de leur articulation à l’adolescence. Revue Française de Psychanalyse, 44, 3-4, 481-522, 1980.
Klein, M. (1947). Deuil et dépression. Paris. Payot. 1968.
Male, P. La crise juvénile. Paris. Payot. 1982.
Racamier, P-C. l’intrapsychique, l’interactif et le changement à l’adolescence et dans la psychose. In “Psychanalyse, adolescence et psychose, pp. 141-152. Paris. Payot. 1986.
Aïcha Ben Milad, psychologue clinicienne, psychothérapeute. Avril 2014.


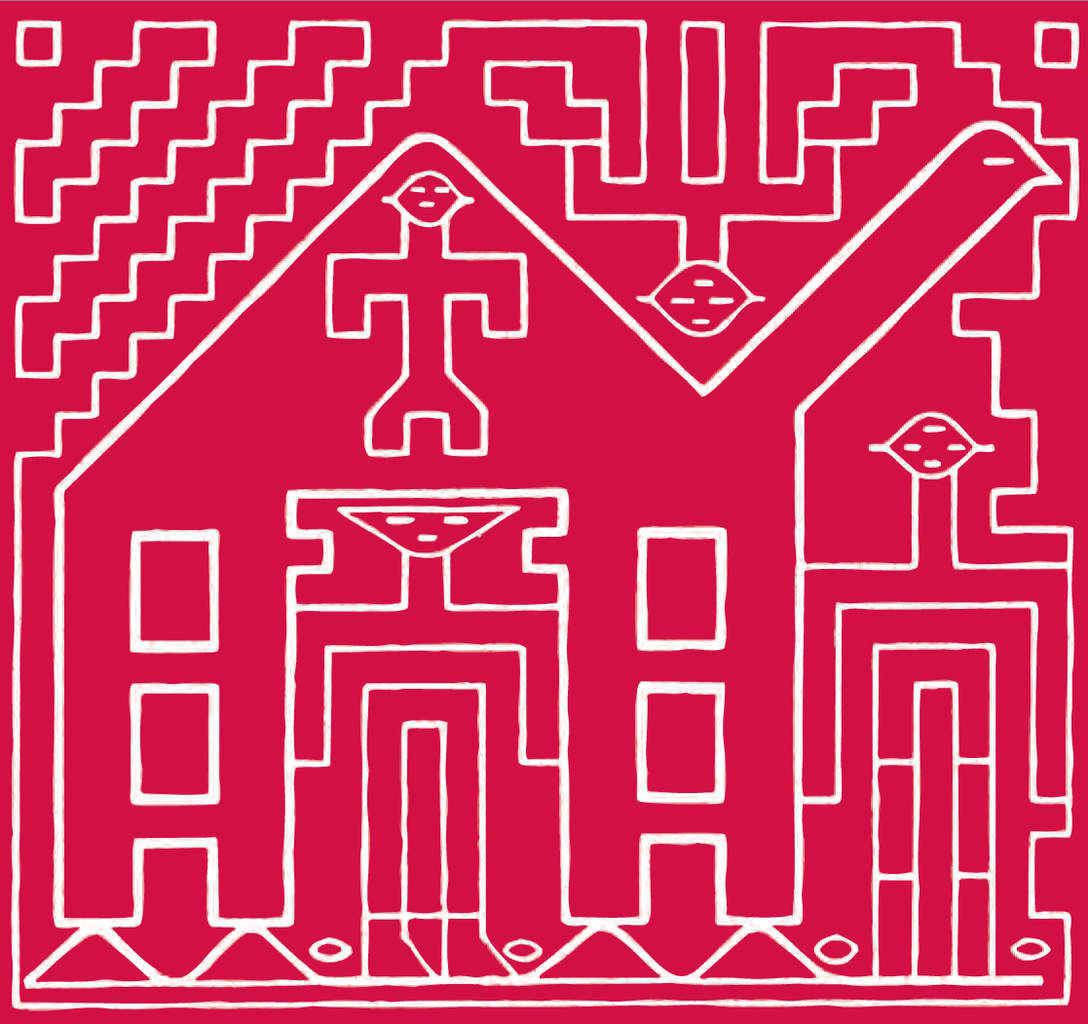
Laisser un commentaire