Lacan élabore, à partir des textes de Freud, ce que sont les objets et leurs manques. Il part de la relation au manque d’objet et non de la relation à l’objet, affirmant le faite que le manque, c’est le ressort même de la relation du sujet au monde.
Ces formes du manque sont la castration, la frustration et la privation.
La frustration est la question centrale, nous dit Lacan. Mais d’abord, avant de parler de ce qui manque, voyons voir de quel objets s’agit-ils ?
1 ⇒ l’objet symbolique L’objet est perdu, il est pris dans une quête. Il est perdu, mais pas oublié : ce n’est pas qu’il n’existe plus, plutôt on veut le retrouver. Il se situe dans l’ordre du symbolique.
2 ⇒ l’objet réel L’objet est halluciné, Freud en parle dans sa référence au principe de plaisir. C’est l’objet qui surgit quand l’enfant hallucine le plaisir lié au sein, par exemple C’est l’objet de l’attente, production mentale du petit d’homme. C’est un objet réel.
3 ⇒ l’objet imaginaire l’objet d’identification : je m’identifie à toi, tu t’identifies à moi. C’est le se faire objet de l’autre, du partenaire amoureux, par exemple.
Dès lors, qu’en est-il quand cet objet vient à manquer ? Quand l’objet symbolique, réel ou imaginaire vient à manquer, cela implique trois formes de manque à savoir la privation, la frustration et la castration.
La notion de privation
Dans sa nature de manque est essentiellement manque réel, c’est un trou, c’est un il n’y a pas. C’est le fait que la femme n’a pas de pénis, qu’elle en est privée. L’objet qui manque est un objet symbolique
C’est logique comment quelque chose pourrait-il n’être pas à sa place, ne pas être à une place où justement il n’est pas ? Du point de vue du réel, cela ne veut absolument rien dire
Lacan disait « Tout ce qui est réel est toujours et obligatoirement à sa place. Même quand on le dérange. Le réel a pour propriété de porter sa place à la semelle de ses souliers. » (p.34)
C’est comme le livre qui manque dans la bibliothèque : on ne peut dire qu’il manque que parce qu’il y a un trou qui marque le manque.
Et ce trou ne marque le manque que parce qu’on le fait entrer dans un ordre symbolique. Le trou présentifie le livre en tant qu’il est absent, parce qu’il se trouve entre le n°1 et le n°3, si on prend une série numérique comme ordre.
Ça veut donc dire que la femme n’a pas de pénis au regard de l’ordre symbolique du « primat phallique ». Il n’y a pas d’exigence phallique pour la privation car comment le sujet peut-il se sentir privé de ce que, par définition, il n’a pas.
Il est important de préciser là que la privation est le nom par lequel Lacan désigne ce que Freud découvre de la sexualité féminine au regard du primat du phallus. C’est à dire que Freud envisage le complexe de castration à partir de l’Œdipe du garçon et Lacan quant à lui considère la privation à partir de la phase phallique chez la fille.
Lacan indique alors que cet objet qui manque dans le réel de la privation, ne peut être donné comme manquant à sa place que dans l’ordre symbolique : la privation est réelle, mais l’objet est symbolique (p. 38).
Pour mieux appréhender ce que cette relation pose, la référence par exemple à l’hallucination du sujet psychotique me semble être intéressante : ce qui fait retour dans le réel, c’est le signifiant forclos, c’est à dire le signifiant pour celui-ci qui n’a jamais pris sa fonction dans la chaîne signifiante et qui manque à sa place.
Du signifiant forclos le sujet ne peut se sentir privé puisqu’il n’en a pas constitué la trace. Si le manque (du signifiant) est réel, ce qui fait retour est un objet symbolique.
La notion de castration
Pour Pontalis « Ce que le garçon a comme appartenance, il faut qu’il le tienne de quelqu’un d’autre : c’est ce que nous avons appelé la dette symbolique, qui inscrit la castration au cœur de la crise formatrice œdipienne. »
introduite par Freud et corrélée à la notion de loi dans la structure de l’Œdipe, elle ne peut donc se classer selon Lacan que dans la catégorie de la dette symbolique.(p. 32)
Notons surtout que l’objet manquant ici dans castration est un objet imaginaire. ( le phallus)
Lacan justifie que l’objet est imaginaire dans la castration , il ne s’agit pas bien entendu de le couper dans le réel, et ce encore moins que cette image phallique est celle qui vaut pour la mère : ainsi Lacan insiste sur le fait que la menace de castration ne produit aucun effet sur le petit Hans par exemple en tant que l’objet phallique n’est pas distingué de sa personne, et tant que la mère n’est pas de quelque façon qui soit appréhendée comme pouvant être privée de l’organe. La coupure en quoi consiste la castration est symbolique, ce qui implique une prise de position du sujet, en effet le sujet susceptible de décider de sa position comme être sexué et qui n’est possible qu’à la condition pour les deux sexes, d’un retour sur la privation cette fois ci non pas du sujet privé du sein, mais de la mère privée de phallus.
Cette privation de phallus est détectée par le sujet lorsqu’il expérimente le fait non pas qu’un autre enfant puisse être satisfait par la mère mais que ceci implique qu’elle désire et que par conséquent elle n’a pas ce qu’elle désire. Pourquoi ne peut-il pas se réaliser sans l’appui d’un semblable ? Ici nous retrouvons ce qui s’était révélé nécessaire pour résoudre le problème du temps logique : Il faut compter jusqu’à trois pour que le point de vue de l’autre soit seulement pensable. Et pour essayer de comprendre ces trois temps il faudrait s’arrêter précisément à cette notion de frustration
La notion de frustration
Dans le tableau présenté par Lacan lors de son séminaire on voit que la frustration est placée au centre. (Frustration ici n’est pas à entendre comme le font les Postfreudiens, qui associent à cette notion la satisfaction, la gratification, l’adéquation, l’adaptation : diverses étapes du développement du sujet jusqu’à plus ou moins complète saturation. )
⇒ Ce n’est qu’un abord imaginaire à ce mode de relation, alors que manifestement l’objet en cause est réel. Et même si on parle d’imaginaire dans la frustration, il s’agit ici du manque d’objet. C’est le manque d’objet qui est imaginaire.
Fondement de l’Oedipe, la frustration est sans doute celui des trois temps freudiens qui doit le plus à Lacan, paradoxalement puisqu’il accuse les post – freudiens d’avoir tout confondu sous ce chef, et donc de l’évoquer à tout propos : en en limitant l’usage, Lacan donne à ce terme tout son poids.
Notons que dans le tableau présenté par Lacan dans le séminaire la frustration est la seule modalité pour laquelle chacun des éléments est précisé et détaillé . C’est bien dit-il
« le vrai centre quand il s’agit de situer les relations primitives de l’enfant » (p. 66).
A Chaque fois qu’il y a frustration d’amour, la frustration se compense par la satisfaction du besoin ; c’est pour autant que la mère manque à l’enfant qui l’appelle, qui s’accroche, et qui s’accroche encore à son sein et qui en fait quelque chose de plus significatif que tout.
Dés lors la valeur prévalente que prend l’objet est précisément fondée sur ceci : qu’un objet réel prend sa fonction en tant que partie de l’objet d’amour, il prend sa signification en tant que symbolique, il devient comme objet réel une partie de l’objet symbolique.
L’enfant donc dans la satisfaction, écrase l’inassouvissement fondamental de cette relation d’amour dans la saisie orale avec laquelle il endort le jeu [absence/présence] – c’est précisément parce qu’elle est entrée dans cette dialectique de substitution de la satisfaction ou exigence d’amour, qu’elle est bien une activité érotisée c’est à dire qu’entre-temps, le besoin est devenu ce que Lacan qualifie de frustration en tant que le dam imaginaire d’un objet réel Ce n’est qu’un abord imaginaire à ce mode de relation, alors que manifestement l’objet en cause est réel. Et même si on parle d’imaginaire dans la frustration, il s’agit ici du manque d’objet. C’est le manque d’objet qui est imaginaire. (sein), dont l’agent est la mère symbolique (absence/présence).
Mais La mère devient réelle, justement pour autant qu’elle frustre cet amour et aussi pour autant qu’elle devient, elle, l’objet (réel) de cet amour : soit l’amour incarné. C’est par rapport au sein donc qu’elle est dite symbolique
Ainsi l’agent est la mère, sous la forme où elle apparaît dans le jeu du Fort – da, comme présence-absence c’est à dire sous une forme symbolique, Lacan nous dit que tel est l’élément nouveau qui clôt le sevrage. Mais avec cette clôture, ça permet de préciser qu’avant il y avait la puissance de la mère susceptible de satisfaire le sujet avec l’objet.
Maintenant celle-ci entre dans la dialectique du don , ce qui implique déjà un échange, soit encore quelque chose qui implique qu’elle n’ait pas tout, qu’elle ne soit pas toute puissante soit encore, qu’elle désire quelque chose (p. 69).
Lacan nous explique que le renversement décrit où l’objet devenu objet du don fait déchoir le statut de la mère de son rang symbolique qu’elle représentait dans le Fort-da ; avec l’objet comme objet réel de satisfaction à cette « réalisation » de la mère dans la puissance de donner ou pas ? Eh ben ! il représente une difficulté dans le passage de la frustration à la castration, un temps d’arrêt nécessaire à la constitution de la phobie, ou encore une voie d’attente dans laquelle l’objet redevenu symbolique n’est plus exactement celui de la privation, mais n’est pas non plus sans rapport avec lui : il ne l’est plus dans la mesure où c’est la mère réelle qui va perdre sa toute puissance.
Ce n’est plus l’enfant qui est privé mais la mère et ceci nous amène à une étape intermédiaire, non indiquée comme telle mais pourtant nécessaire aussi bien pour rendre compte du développement normal, que surtout pour rendre compte des différentes structures cliniques : outre la phobie qui est située ici, il y a la toute puissance de la pensée pour laquelle la toute puissance de la mère nous est donné comme un passage obligé(p. 69).
Pour avoir une notion juste et plus claire de ce qui est central dans la relation mère enfant, Lacan propose de l’aborder sous deux versants distingués pour la compréhension, mais néanmoins accolés.
Il y a d’une part, l’objet réel et d’autre part, l’agent (ici la mère).
L’objet comme nous l’avons déjà dit, n’a d’instance et n’entre en fonction que dans son rapport au manque. L’agent est nécessairement à introduire ici comme point actif, agissant sur l’éventuel manque de l’objet. La mère n’est pas prise comme objet tout entier , même si elle porte le sein et justement comme elle porte le sein, elle n’est pas toute entière « un sein » . Et c’est en cela qu’elle est agent, qu’elle agit en rendant ce sein présent ou absent. D’où l’intérêt d’introduire cette distinction : objet réel et agent, parce qu’elle ouvre à la dichotomie sein et mère. La mère en rendant le sein une fois présent, une fois absent ne répond pas toujours à l’appel de l’enfant. En témoigne très tôt l’enfant qui joue à lancer une balle ou tout autre objet d’ailleurs , et à la rattraper par la suite. C’est ce jeu du Fort-Da décrit par Freud et citer auparavant où l’enfant met en scène le couplage présence-absence.
Cette Présence–absence de la mère qui ne répond pas, toujours à l’appel de l’enfant. Cette présence-absence est l’amorce de l’ordre symbolique
Cette opposition présence-absence, est plus-moins la condition fondamentale de l’entrée dans l’ordre symbolique. La frustration est donc nécessaire. La mère suffisamment bonne, comme disait Winnicott, joue un rôle essentiel dans la venue de l’enfant au langage. Dès lors, les choses se complexifient et la relation mère-enfant s’ouvre à une dialectique.
Posons la question maintenant de ce qu’il en est , quand la mère ne répond plus à l’appel.
Et bien, alors qu’elle faisait partie de la structuration symbolique qui la faisait objet présent- absent en fonction de l’appel, elle déchoit et devient réelle. Elle devient une puissance qui détient l’objet de satisfaction, qu’elle peut donner ou pas. L’objet devient alors à son tour un objet de don, c’est-à-dire objet qu’il peut recevoir de sa mère et qui représente le don qu’elle peut lui faire, il devient objet symbolique portant la marque de la valeur de cette puissance. La position s’est donc renversée : la mère est devenue réelle et l’objet symbolique. L’objet dès ce moment, a la possibilité de satisfaire sur deux plans : d’une part, comme avant, il satisfait un besoin (de nourriture par exemple) et d’autre part, il symbolise une puissance favorable. Un rang de satisfaction naturelle, et puis un rang de satisfaction qui n’est plus naturelle : l’objet arrive comme don. Ce bouleversement introduit à un autre registre, l’objet devenu objet de don est aussi ce qui peut se refuser.
Voilà donc comment cette notion de frustration peut autre abordée du point de vue de l’enfant avec toutes ces conséquences.
Lacan nous propose d’aborder cette même question (quand l’objet vient à manquer) avec comme point de départ, la mère, toujours en partant des textes de Freud.
Du côté de la mère, l’objet qui manque, c’est le phallus. Cet objet est défini comme imaginaire et il a un rôle décisif pour les femmes à qui il manque le corrélat réel c’est a dire (l’organe) la mère manque de phallus et cela a un rapport dans la relation qu’elle a à son enfant . Il est important de noter aussi que aussi bien la mère que l’enfant attend et reçoit quelque choses de l’autre ; ils sont dans ce rapport dit dialectique.
Mais l’image du phallus n’est pas ramenée à l’image de l’enfant. Ce n’est pas en effet la pleine harmonie entre les deux. On a vu que la mère – et cela est nécessaire – n’était pas toujours à disposition pour l’enfant. On se rend compte à présent que l’image de l’enfant ne sature pas complètement le manque de la mère. Il y a là quelque chose d’irréductible. Lacan ajoute qu’en suivant Freud, on peut dire « que l’enfant en tant que réel symbolise l’image. Plus précisément – l’enfant en tant que réel prend pour la mère la fonction symbolique de son besoin imaginaire – les trois termes y sont » imaginaire symbolique et réel. (p. 71)
Cela veut dire que l’enfant réel pour la mère ce dont elle a besoin imaginairement et qui lui manque. L’enfant s’aperçoit qu’il n’est pas aimé pour ce qu’il est, mais pour une certaine image. Et si on va plus loin, on s’aperçoit que c’est là qu’intervient la relation narcissique, au moment où l’enfant prend sur lui l’image phallique.
Pour conclure on peut dire que dans la névrose, Lacan aborde deux façons de faire avec la rencontre de la castration féminine et de l’angoisse qui y est liée : d’une part, l’enfant s’identifie au phallus et il devient fétiche de la mère. Ou bien, d’autre part, il se construit une phobie pour parer à l’angoisse de castration féminine.
Dans la psychose, par contre on voit que l’enfant occupe la place d’objet dans le fantasme maternel ; la mère s’en comble complètement. L’enfant ici donc vient alors boucher la question du manque.


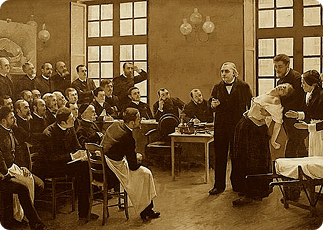
Leave a Reply