Voilà un exemple de ce que Freud appelait « attente croyante », croyance que le patient met en nous avant même de nous connaître, croyance animée par une conviction et un désir inconscient de pouvoir avec nous, ou à travers nous plutôt, trouver une solution. Dans cet exemple la jeune patiente veut m’instituer à la place d’un Dieu, qui aurait un savoir et un pouvoir apparemment absolu, mais en réalité un Dieu qu’elle pourra utiliser comme une marionnette, en faisant reconnaître peu à peu dans ce jeu son désir.
Ce qui a été raté, dans sa construction de sujet, c’est le rôle qu’elle a joué, enfant, de thérapeute de sa mère, comme disait si bien Dolto, assignation exclusive de tout autre désir.
Mais en même temps, au-delà de ce Dieu qu’elle me demande d’incarner dans l’imaginaire, elle va trouver dès le début ma croyance réelle dans le sujet qu’elle peut devenir, la « supposition de sujet » qui lui a tant manqué.
Dans la vaste littérature sur ce sujet, vous avez pu prendre connaissance des témoignages sur les effets constatés directement chez les bébés, qui savent sans paroles très bien exprimer leur souffrance, effets négatifs d’une mauvaise relation avec la mère mais également effets positifs de l’intervention réparatrice par la parole.
Nous retrouvons également les conséquences des carences de la croyance de la mère à l’égard de son enfant, chez les rescapés que nous recueillons sur nos divans, en assumant un pari pascalien grâce à notre croyance dans l’efficacité du processus analytique.
On dirait un paradoxe dans le cas de ces ratés qui se sont vérifiés au cours de la relation précoce mère-enfant : une cure par la parole de blessures sans mots. Et pourtant c’est là que nous touchons vraiment à la puissance pacificatrice des mots, c’est là que nous voyons se tisser des trames symboliques qui couvrent des trous, des gouffres, ressentis comme réels et même corporels, ou qui sont projetés inconsciemment dans des constructions imaginaires terrifiantes, menaçantes, persécutrices. Nous retrouvons avec nos analysants adultes les anciennes blessures, enfouies, masquées, inconsciemment rejetées, non seulement parce que perdure la conviction de ne pas pouvoir y faire face, inélaborables comme à l’époque du trauma, mais aussi parce que cette supposée incapacité contraste totalement avec des personnalités qui d’une façon ou d’une autres se sont construites dans une lutte permanente très énergique et courageuse, apparemment performante narcissiquement, faux self derrière lequel se cache un sujet clandestin, interdit de séjour.
Nous sommes loin de la croyance de la mère qui, au mieux, « suppose un sujet » et par cette supposition l’institue. La mère qui plus souvent désire, bien sûr inconsciemment, plutôt et avant tout un objet qui devrait la satisfaire, ou, pire, qui va lui permettre de renverser du passif en actif ce qu’elle a elle-même subi de sa mère à elle. Dans ces cas la croyance de la mère peut être interprétée quand même par l’enfant comme un certain désir qui lui laisse une marge de manœuvre : il peut se faire objet de désir, poupée parfaite, se complaire dans l’illusion de combler sa mère, dans ce que Lacan a appelé le jeu de leurre qui est déjà intersubjectif. Il peut ressentir la croyance de la mère, une croyance qui le conditionne, qui l’emprisonne, ou qui le déçoit comme inassouvissable, mais une croyance tout de même.
Parfois nous retrouvons dans nos patients un raté plus grave de la relation précoce mère-enfant, le non-désir, l’anti-croyance. Plus grave parce qu’il peut empêcher l’existence de ce bébé-sujet futur, ou conditionner lourdement son sentiment de droit d’exister tout court. Mais plus grave aussi parce que plus difficile à cerner et à élaborer en analyse, plus facilement obnubilé par les fantasmes et la terreur. Plus grave enfin pour les implications sur le maniement du transfert d’une défiance totale envers le soutien de l’autre, en soi contradictoire avec la confiance en nous dont ils ont besoin, et pour la difficulté de saisir les formes différentes de remémoration et de répétition à analyser et élaborer.
Sur le divan de ces adultes la remémoration pour la période bébé passe par le filtre souvent unique d’un « ma mère m’a dit », qui brouille les pistes entre le trauma supposé vécu et la transmission du récit de la mère avec ses intentions inconscientes. Trauma du vécu ou trauma du récit ? Freud répond à ce genre de questions par l’importance des souvenirs-écrans qui, affirme-t-il, « contiennent non seulement quelques éléments de la vie infantile, mais encore tout l’essentiel. Ils représentent les années oubliées de l’enfance aussi justement que le contenu manifeste des rêves en représente les pensées ».
Comme un souvenir-écran, le récit de « ma mère m’a dit » apparaît dans le discours de l’analysant comme un scénario en dehors du temps, qui n’est jamais questionné, qu’elle soit vivante ou morte, comme s’il ne pouvait pas être réélaboré. Ce scénario se complète peu à peu avec des détails, mais toujours sans ressenti ni recul. Le souvenir ne lui appartient pas et le récit de la mère est en soi une sorte de confirmation de la passivité sans recours du bébé d’avant, un deuxième temps ressenti aussi traumatiquement que le vécu originaire mais sans aucun signe d’identification imaginaire. Ce deuxième temps en paroles nous permet de mobiliser graduellement la pensée de l’analysant, qui refuse au début de croire à ce qu’il considère comme un déterminisme qui l’emprisonne, un déterminisme passivement subi. Face à ses tentatives de banaliser l’importance de ce trauma dans sa vie, c’est notre image de sujet supposé savoir qui peut faciliter son acceptation de notre croyance dans leur capacité de faire face à une réalité psychique qu’ils ont enfouie parce qu’impossible à supporter dans le passé mais possible à élaborer dans ce présent avec notre soutien.
L’autre aspect déterminant en analyse est constitué par le processus de subjectivation qui devrait permettre de se reconnaître sujet après coup jusqu’à l’identification pacificatrice avec ce bébé d’avant, en retrouvant une certaine « continuité d’être ».
Lacan fait longuement référence aux enfants non désirés (dans son Séminaire V sur « Les formations de l’inconscient ») : « C’est l’expérience qui nous a appris ce que comporte de conséquences en cascade, de déstructuration presque infinie, le fait pour un sujet, avant sa naissance, d’avoir été un enfant non désiré. Ce terme est essentiel. Il est plus essentiel que d’avoir été, à tel ou tel moment, un enfant plus ou moins satisfait. Le terme d’enfant désiré répond à la constitution de la mère en tant que siège du désir, et à toute la dialectique du rapport de l’enfant au désir de la mère… »
Tout en soulignant les difficultés qui en découlent en analyse, Lacan nous indique par ailleurs que ces cas difficiles nous enseignent des aspects essentiels de la conduite de toute cure : « Ce qui nous apparaît ici à nous, analystes, dans ces cas, est exactement ce qui se retrouve dans les autres, à savoir la présence d’un désir qui s’articule, et qui s’articule non pas seulement comme désir de reconnaissance, mais comme reconnaissance d’un désir ».
Nous pouvons en déduire l’importance de notre croyance dans la voie de l’exploration de ce désir que nous supposons avant de le reconnaître.
Je vais vous donner un exemple très partiel pour illustrer ce processus.
« Ma mère m’a dit qu’elle voulait avorter » : Marie ne se rappelle ni quand ni où sa mère a dit ça. Mais elle se rappelle l’étrange motivation déclarée par sa mère : « je devais être opérée d’appendicite au cinquième mois de grossesse et j’ai demandé d’avorter parce que je ne voulais pas que le bébé naisse sans un bras ou sans une jambe…le chirurgien m’a convaincue finalement ». De cette explication très farfelue, restée gravée, sans questionnement, Marie a déduit une série de fantasmes sur les conditions requises pour un permis de vivre, à la conquête effrénée de phallus divers, chaque fois dévalorisés et inefficaces pour combler ce non désir de sa mère. Seulement après quelque années d’analyse, Marie a pu chercher dans un vieux journal de sa mère morte une phrase écrite quand elle était enceinte de cinq mois, qu’elle avait déjà lu et totalement refoulée, une autre version où le désir de la mère se dévoilait clairement : « je ne veux pas de cet enfant, je voudrais rester libre ». Elle a ainsi pu se confronter au fantasme d’une mère meurtrière, dont le verdict ne dépendait ni d’un avoir ni d’un être de sa fille. Elle a alors pu reconstruire un scénario imaginaire de sa lutte pour la survie dans le ventre peu accueillant de sa mère, comme le symbole d’une prise à son compte de son désir de vivre et de son droit d’exister. Symbole aussi de la séparation et du passage d’un objet passivé et aliéné à la fierté de cette capacité de survie, qui devenait un élément fondamental et permanent de son Idéal du moi, au lieu de rester un mécanisme inefficace d’un scénario répétitif de mise en danger.
Cette étape, fondamentale bien sûr, de désidentification d’un objet impossible du non désir de sa mère, n’était cependant pas suffisante. Sa construction d’un Idéal du moi pacifié s’est poursuivie d’une autre façon et lui a permis de ne pas demeurer dans un « exister contre » représenté quand même par un corps à corps avec la mère inconciliable. La pacification ne pouvait pas se faire sans le rétablissement progressif d’un certain lien symbolique avec la mère, qu’elle a pu retrouver dans la même phrase écrite par sa mère : « je voudrais rester libre ». Cela m’a fait penser à l’identification à un trait unique, inscrite par le sujet dans son Idéal du moi, une sorte d’identification que j’ai souvent constaté avec étonnement vers la fin de certaines analyses. Etonnement pour la capacité de bricolage animée par ce désir qui se révèle tout d’un coup prioritaire.
L’Idéal du moi, dans le cas de l’enfant non désiré ne peut pas se constituer de la même façon, en se désaliénant progressivement du désir de la mère pour retrouver un désir propre du sujet qui est déjà là, caché, suffoqué, inhibé ou interdit.
Ce que nous retrouvons de désir dans la vie d’un enfant non désiré n’a pas été construit par un processus graduel de différentiation de l’image désirée par la mère. Le processus de subjectivation doit se différencier d’un « non-désir » qui a été défini autrement comme pulsion de mort. Face au non désir de sa mère le sujet doit arriver à « faire la mère de soi-même » comme l’a si bien dit un écrivain (Nathalie Sarraute). Il doit remplacer cette mère non désirante par une mère intérieure capable, elle de croire et d’assumer son propre droit d’exister.
Mais avant d’y arriver son parcours sera semé d’aliénation au désir de l’Autre sous plusieurs formes, d’autant plus passionnelles qu’elles recouvrent la recherche vitale de confirmation du droit d’exister. C’est souvent au cours d’un accident de cette confirmation, jamais acquise, qu’ils arrivent sur notre divan.
Nous sommes alors confrontés à un transfert passionnel plus difficile à manier.
Un élément important est justement la croyance qui se confronte à un doute permanent, un doute originaire : « pourquoi ma mère ne m’a pas désiré, et pourquoi elle m’a fait naître quand même ? ».
Ce doute est ruminé et revisité, ou bien totalement refoulé, et se réfère dans le discours de l’analysant à un « ma mère m’a dit » lapidaire.
Derrière ce doute il y a la terreur de devoir détruire une image intérieure idéalisée pour contrebalancer l’inacceptable et en même temps une sorte de culpabilité existentielle originaire qu’ils exhibent dans des séances d’auto- dévalorisation violente. Nous sommes appelés plus que jamais à maintenir une vraie neutralité bienveillante, mais à ne pas la confondre avec une indifférence, ou un refus d’implication. Nous sommes appelés à reconnaître avant tout la souffrance et à nous impliquer, sans prendre parti, dans la lutte à la conquête de ce droit d’exister qu’ils sont venus chercher chez nous sans le savoir.
Un autre exemple de mon expérience à ce propos : « ma mère m’a dit que j’ai eu une maladie respiratoire quand j’étais bébé, dont elle ne s’était pas aperçue, un médecin m’a aperçu par hasard et m’a sauvée en m’hospitalisant en urgence en isolement pendant des semaines sous une tente à oxygène » : Nicole me dit par ailleurs que sa mère a été toujours alcoolique, « pétée » tous les soirs.
Après quelques années d’analyse elle arrive à résumer son manque de droit d’être non seulement aimée mais même embauchée dans le travail par un défaut corporel qu’elle présente comme irréparable, sa grande taille, alors qu’elle est très jolie. Expression corporelle d’une carence archaïque indicible. Son discours passe peu à peu à une plainte différente (« je suis nulle »), qui m’est adressée. Il s’agit d’un jugement qui laisse la place à des interprétations, des élaborations, des raisonnements logiques, qui échappent au fantasme irrévocable de sa taille et ouvrent enfin à la construction d’une reconnaissance : toute seule, bébé, sous la tente à oxygène, elle a pu quand même s’en tirer avec son désir de vivre : elle a montré des « compétences », elle n’est pas nulle. Elle peut trouver une continuité d’être avec le bébé qu’elle assume enfin.
Elle peut extraordinairement réinterpréter même sa grande taille comme le signe de son propre désir d’exister, et de sa volonté de vivre son histoire à elle, libérée des multiples conditionnements douloureux qu’elle a subis. Elle me dit « je voudrais le déclarer en vous regardant dans les yeux ». Je pense alors au regard de la mère qui lui a « fait défaut » dans tous les sens du mot. Je lui demande si mon regard lui manque sur le divan. Elle me répond que, non, qu’ il n’y a pas eu une minute où elle n’a pas ressenti ma « double présence ». Ce qu’elle appelle ma double présence s’oppose à une mère présente qui n’est pas là, à ce que Green a appelé la « mère morte », une double présence que je traduis « implication croyante » justement.


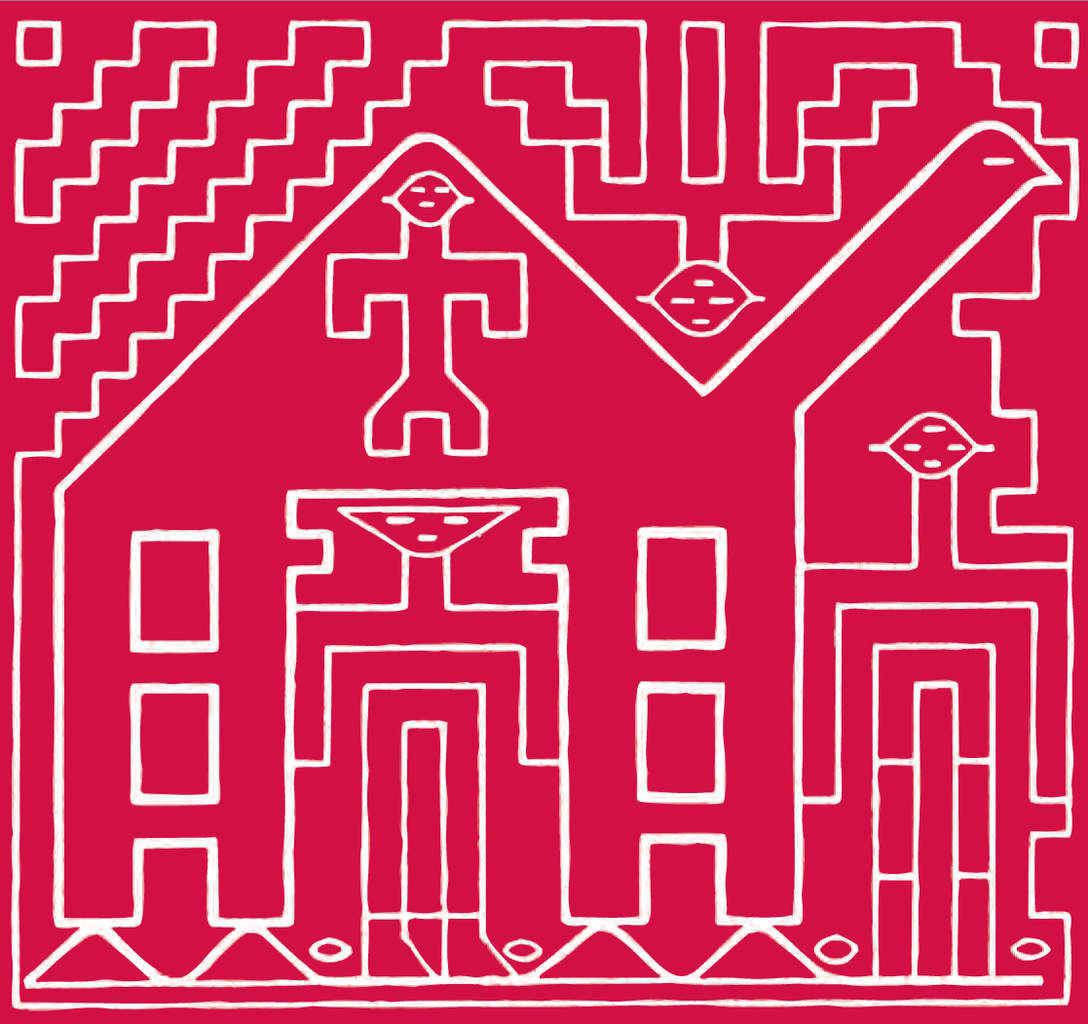
Laisser un commentaire