« Etre mère » pose la question de la maternité à laquelle toute femme répond par sa modalité propre : ambivalence, refus, désir ou impossible…
C’est de cette femme (la mère) que le nourrisson reçoit les premiers soins, satisfait ses besoins physiologiques et libidinaux. Première séductrice, écrit Freud, car pourvoyeuse de lait, la mère est aussi pourvoyeuse de plaisir, la pulsion s’étayant sur le besoin au début de la vie. Le petit enfant jeté dans le monde dans un état d’immaturité et de dépendance totale est ainsi entièrement livré aux soins maternels. La mère, l’adulte qui en a la charge peut en disposer à son gré, faire de son corps ce que bon lui semble.
Ensuite, cette relation est décrite sous l’angle masculin, car ce qui intéresse Freud au premier chef c’est la relation mère-garçon.
La primauté accordée par Freud au pénis, combinée à la vision d’un maternel phallique, paré de toutes les perfections, devait nécessairement faire de la mère un être bisexué, dans la tradition mythologique ou platonicienne1. À l’autre extrême, ceci dissimulant cela, et suscitant l’effroi, la castration représentée par la figure de la Méduse1.
Freud fait de l’envie du pénis le ressort du complexe d’Oedipe chez la fille au moment de la phase phallique, découverte lourde de conséquences pour elle.
De cette envie du pénis, il tire des conséquences psychiques pour la sexualité féminine. La mère, est désignée comme responsable de ce qui manque à la fille, le pénis. Pour Freud, c’est un véritable « préjudice ».2
En 1931, sur la sexualité féminine, Freud accentue encore la haine à l’égard de la mère. Ce sentiment d’hostilité est strictement corrélé au destin du phallus chez la fille. Ce qui explique cette haine pour Freud, c’est « que la mère a omis de munir la petite fille du seul organe génital correct ; elle l’a contrainte à partager l’amour maternel avec d’autres, elle ne remplit jamais toutes les attentes… »
En 1933, Freud expose sa conviction que « l’on ne peut pas comprendre la femme si on ne prend pas en considération cette phase de l’attachement préoedipien à la mère ».3
Freud a remarqué par l’analyse des femmes que, même quand le lien avec le père est particulièrement intense, il y avait auparavant une phase de lien exclusif à la mère aussi intense et passionnée. De plus, Freud repère que cet attachement à la mère est fortement sous-estimé et force est d’admettre que : « Nombre d’êtres féminins restent attachés à leur lien originaire avec la mère et ne parviennent jamais à le détourner véritablement sur l’homme ».3
Voici la thèse que Freud avance : « la forte dépendance de la femme vis-à-vis de son père ne fait que recueillir la succession d’un lien à la mère aussi fort et que cette phase plus ancienne persiste pendant une période d’une durée inattendue »3
Ainsi, deux plans peuvent se reconnaître de l’identification à la mère chez la femme :
– un plan pré-oedipien qui repose sur le tendre attachement à la mère et prépare son futur rôle dans la fonction sexuelle et dans sa vie sociale.
– Un plan issu du complexe d’Oedipe (qui veut éliminer la mère et la remplacer auprès du père).
Ces deux plans subsistent ensemble et cela n’est jamais surmonté de façon suffisante… témoignant, de la complexité des positions de l’être femme, de l’être mère et du lien maternel.
Toute la théorie de Freud met en équation maternité et castration. On pourrait avancer à travers ces quelques références que la norme féminine pour Freud est réductible à une position maternelle, c’est-à-dire du passage de l’envie du pénis au désir d’enfant. Mère phallique qui a, qui ne manque pas, comblée par l’enfant-phallus.
Lacan ou le désir de la mère. Que nous dit Lacan quant à l’être mère ?
La notion fondamentale que Lacan transmet est celle de la dépendance primordiale du sujet par rapport à l’Autre, au désir de l’Autre. Qu’est-ce que le désir de l’Autre ? Le désir est, en tant que tel, modelé par les conditions de la demande et en cela, il n’est pas réduit à la satisfaction des besoins primaires. En effet, la demande est, contrairement au besoin, adressée à un autre. Dans la structure du sujet s’inscrivent, « les péripéties, les avatars, de la constitution de ce désir, en tant qu’il est soumis à la loi du désir de l’Autre”.4
Ce désir de l’Autre, c’est le désir de la mère et ce qui importe c’est la reconnaissance du sujet par rapport à ce x du désir de la mère, y répond-il ou non, est-il ou non l’être désiré ? L’enfant est soumis à « la loi de la mère, à la loi du désir, du fait que la mère est un être parlant, même si cette loi est incontrôlée ».4
Rencontres cliniques
Layla consulte pour une dépression. Jeune professeur d’anglais, fille unique dans une fratrie de trois garçons, au visage rond, souriant et à la dégaine infantile, elle est célibataire. Elle évoque toujours sa mère dans la douleur : « ma mère ne m’aime pas, elle n’aime que ses fils, je ne peux pas oublier la haine et le mépris qu’elle a exprimé à mon égard ; petite, elle me considérait comme la bonne à tout faire, je suis et je me sens cette chose abominable. Elle me disait souvent, si j’avais su que tu allais être une fille je t’aurais, tué, étouffé ; tu es moche, vieille fille, aucun homme ne t’épousera, tu es incapable d’être mère ».
La mère de Layla a vécu une relation pénible et douloureuse avec sa propre mère, née elle aussi après trois garçons morts en bas âges. La grand-mère attendait l’enfant de substitution un garçon, quand la mère de Layla vint au monde. Elle était également maltraitée par sa mère. Layla évoque que des proches lui ont rapporté que sa mère a beaucoup pleuré le jour de sa naissance, comme la grand-mère a beaucoup pleuré à la naissance de sa mère. Cette dernière devait multiplier les preuves de bonne conduite, secondait sa mère dans toutes les tâches domestiques et dans la prise en charge des plus petits. Schéma qu’elle a infligé à son tour à Layla.
Venue au monde, Layla rencontra donc une mère endeuillée, usurpatrice car n’ayant pas pu remplacer des frères ainés morts. Il est probable que ce deuil ait été ressenti comme un abandon affectif. Elle a pu se sentir au cours de son enfance responsable de la dépression maternelle devant laquelle elle était impuissante, s’attribuant la responsabilité du malheur maternel. Fautive et coupable, elle va se percevoir comme un mauvais objet que la mère ne peut pas aimer.
Layla a partagé la souffrance de sa mère, une mère éplorée, déprimée, abandonnée, privée de satisfaction affective. La mère répète, égrène inlassablement les subis à sa fille, Ferenczi parle dans ce cas «de terrorisme de la souffrance » (1932)5, c’est à dire des spectacles des malheurs imposés par l’adulte, entrainant une confusion des affects.
Layla me parle « des monstruosités et des horreurs maternelles dans sa famille, tante maternelle, grand-mère et arrière-grand-mère… », inceste, enfant illégitime issu de l’inceste, prostitution… « J’aimerai tant me détacher de ces mères toxiques de mon histoire !»
Layla traine la honte, le mépris, le sacrifice, la mère, les mères, la femme, l’inceste… elle traine comme elle le dit « toutes ces mères toxiques ».
Le cas de Layla met en lumière les violences et incidences générationnelles, les répétitions trans-générationnelles, les souffrances portées par un sujet qui semblent s’originer bien avant sa naissance. Lacan parle du « malentendu de la naissance » : « Qu’êtes-vous d’autres que des malentendus ? »6. Car la construction du rapport à l’Autre passe par le langage. L’enfant nait. Il y a d’abord un corps. Puis il parle. L’Autre parlait avant lui. L’existence de symptômes résulte du fait que de génération en génération, le langage est transmis. Or la langue est un malentendu. Plus on cherche à dissiper un malentendu, plus il est renforcé, nourri. Philippe Lacadée, psychanalyste, précise que ce malentendu « est d’avant, dans le lieu de l’Autre qui nous préexiste – dans ce que Lacan a appelé le « bafouillage de nos ascendants »7. Le traumatisme de la naissance, c’est de naître désiré, désiré sur fond de malentendu posé de structure au point d’équivaloir au corps du sujet »7.
Maha, 48 ans, ainée de quatre filles et mère de deux filles, consulte pour une dépression avec une conduite boulimique, divorcée et remariée elle avait peur de reproduire encore le schéma de son premier divorce. Au fil des entretiens apparaît le ressenti qu’elle a envers sa mère, toujours jugée par cette dernière : elle la qualifiait « de pas jolie », ayant de laides et grosses jambes et ressemblant à son père. La mère voulait un garçon quand elle était enceinte de Maha. Maha a souffert de boulimie pendant toute son adolescence. Très culpabilisée, elle parle de sa fille ainée pratiquement à chaque entretien ; « être mère c’est quoi ? Ma mère m’a dit que tu n’es pas une bonne mère pour tes filles ». Maha fait une TS en post-partum car elle ne savait vraiment comment être mère. Sa fille est boulimique vomisseuse avec des antécédents de TS. Quand elle vomit, elle enlève tous ses vêtements, se met devant la glace de la salle de bain et vomi. Sa fille lui dit un jour : « est-ce que tu m’aimes à présent : je prends ma douche régulièrement, je suis plus sale comme mon père, je ne lui ressemble plus, tu devrais m’aimer plus et me regarder plus ? »
Quelle violence se trame dans cette relation ?
Dans violence il y a « viol », le viol n’est pas uniquement sexuel, il peut être la réduction d’un corps à un objet de manipulation, de plaisir ou d’horreur, un pur objet de jouissance. La faim c’est la faim de l’Autre, d’un autre qui n’a pas été là pour apprendre à dire « je » et « tu ». La maitrise que leur donne le fait de se faire vomir est préférée au fait de supporter le poids de cette attente d’amour rendue vaine, parce que cela donne un pouvoir imaginaire. Le pouvoir fait « comme si » c’étaient-elles qui ne voulaient plus de l’amour maternel et non l’inverse, alors qu’en réalité, elles vivent dans l’enfer quotidien de leurs crises, l’impossible coupure du lien ombilical.
C’est un corps parfait et imaginaire que Maha et sa fille ont voulu atteindre, le corps de l’Autre.
Elles tentent de se séparer d’une mère qui voudrait inconsciemment les posséder, s’emparer, jouir d’elles. On entend leurs convulsions, leurs terreurs, leur jouissance violentes du vomissement, le calvaire de ce secret : se nourrir pour vomir. On réalise que le tyran dont il faut les délivrer n’est pas seulement la mère. Mais rien n’y suffit. C’est une guerre qui se nourrit d’un amour violent, d’une dépendance impossible à dénouer ; un pacte inguérissable.
Une culpabilité qui abrite un sentiment de toute puissance auquel elles ne sont pas prêtes non plus à renoncer. Une toute puissance qui les fait exercer sur leur corps même ce calvaire répété dont elles ont secrètement la maîtrise. Enchainées à la souffrance maternelle, elles le sont à leur propre corps comme un pur objet. Comment le corps qu’on « a » peut-il devenir le corps qu’on « est » ?
Lien maternel, amour et violence
Les présentations de Layla et Maha illustrent à quel degré ou à quel point le lien maternel peut être violent, sauvage. Le terme de « sauvage », à propos du lien maternel, trouve alors une définition plus précise : ce qui, dans l’ombre d’un maternel « civilisé », policé, réprimé, est susceptible de se déchaîner dans l’amour comme dans la haine, de s’adonner à la violence.15 Car il y a du sauvage dans l’être mère qu’il convient de dompter, de refouler.
L’amour maternel est un lien à établir, à maintenir, à relâcher et à transmettre.
Pour pouvoir mettre en place le lien avec l’enfant, la mère doit faire le détour et le retour régressif par le lien avec sa propre mère. Quel que soit la nature de ce lien, la mère « naissante » va puiser dans son histoire précocissisme, voire archaïque, le fond relationnel et affectif que lui a légué sa propre mère.
Parallèlement, la mère met en place un processus d’élaboration mentale du bébé. Il s’agit d’une véritable grossesse psychique qui peut commencer avant la grossesse physiologique. Dans ses représentations mentales, la mère donne déjà naissance à un bébé idéal qui résume en lui les désirs de la mère, mais aussi ses craintes et ses angoisses. Il est surtout le sujet imaginaire qui permet à la mère d’anticiper le « tricot » relationnel avec l’enfant réel. Le lien imaginaire de la mère au bébé idéal préfigure et prépare les relations de la mère au bébé qui va naître.
Le bébé réel n’a rien à voir ou si peu avec le bébé idéal, et passé le deuil du rêve c’est bien vers le bébé charnel que la mère va effectuer son premier don involontaire. Ce don c’est le transfert, au sens psychanalytique du terme, du fonds affectif qu’elle est allée chercher dans le temps de régression de la grossesse.
Dans ce don est transmis tout ce qui ressortit au lien trans-générationnel, c’est-à-dire non seulement les affects qui sont marqués par la relation mère grand-mère, mais aussi tout le sédiment historique des générations précédentes.
Dès lors tous les incidents historiques ou préhistoriques glissés dans ce sédiment peuvent faire résurgence et perturber le processus du « tricotage » du lien, tel le cas de Layla.
À travers l’échange des regards, des gestes, des mots, la mère va constituer un cadre sécurisant et cohérent qui permettra à l’enfant : – de constituer son sentiment d’intégrité corporelle à travers la sécurité interne que lui procurent les échanges physiques, à travers les soins du corps, le handling. L’enfant pourra surmonter ses angoisses de morcellement et avoir un sentiment de « méméré d’être » au sens de Françoise Dolto 9 – en répondant de façon cohérente aux besoins de l’enfant, la mère va permettre la construction d’un sentiment de continuité affective : les mêmes besoins de l’enfant entraînent plus ou moins les mêmes réponses que la mère. L’enfant établit un repérage interne de sa relation à la mère.
Mais la mère est traversée elle-même par son ambivalence affective et par l’impossibilité de l’invariance ; elle n’est donc jamais totalement cohérente et jamais totalement satisfaisante. C’est l’écart qu’il va y avoir entre la mère « entièrement bonne » et la mère « suffisamment bonne ». C’est cet écart qui va donner à l’enfant suffisamment de jeu dans le lien qui le relie à sa mère pour que ce lien, tout en restant solide et sans le ligoter, puisse un jour se distendre et lui permettre l’accès à l’autonomie. La cohérence de la mère donne à l’enfant le sentiment de sa valeur, l’enfant se sent aimable.
Une fois confirmé, ce lien va devoir se maintenir en évoluant au fil de la croissance de l’enfant, en accompagnant son autonomisation progressive. La mère devra aimer à chaque étape de son développement l’enfant nouveau qui advient sans renier l’enfant qu’il n’est plus mais qu’il reste encore. La mère est sans arrêt invitée à devenir mère autrement. C’est un accordage permanent de la relation mère/enfant, un exercice périlleux d’improvisation et de retrouvailles.
Un lien à relâcher : suffisamment soutenu par un lien qui lui donne cohérence et continuité, l’enfant va pouvoir peu à peu prendre une distance physique par rapport à sa mère, acquérir son autonomie ainsi que son estime de soi, son autonomie psychique, et expérimenter sa « capacité d’être seul » au sens de Winnicott. Cette étape va dépendre de la capacité que la mère aura à introduire des ruptures dans le lien.
Et enfin un lien à transmettre : L’enfant s’est éloigné de sa mère, chargé de l’histoire familiale qui le situe dans sa lignée. Il s’en va également muni du sentiment de valeur et de la sécurité interne qui lui sont donnés par ses parents. Ayant été aimé, il se sent suffisamment aimable et va pouvoir aimer à son tour. Ainsi s’enchaînent les générations quand l’enfant a reçu la capacité de transmettre l’amour. Mais pour cela, l’enfant doit se délier de ses parents et plus particulièrement de sa mère. Or il est en dette de ce côté-là car il a beaucoup reçu. Cette dette, il ne pourra la régler, et ce qu’il a reçu il ne le rendra pas à sa mère, mais à ses propres enfants. Du côté de l’enfant, il reste donc inévitablement une culpabilité, et du côté de la mère, un sentiment de perte. C’est là que le processus de transmission peut achopper : à ne pas accepter cette perte, la mère peut figer son enfant dans une culpabilité qui lui interdira de poursuivre la chaîne humaine de l’amont vers l’aval.
Je conclurais avec cette phrase de Freud : « Tout dans le domaine de cette première liaison à la mère m’est apparu difficile à saisir psychanalytiquement, blanchi par les ans, pareil à une ombre, à peine susceptible d’être rendu à la vie, comme si cela avait succombé à un refoulement inexorable. »10
Et si le lien maternel lui-même n’était qu’une ombre qui dérobe à nos sens son corps véritable ? C’est que du maternel, la nature véritable reste à jamais inconnaissable, si ce n’est à travers l’imaginaire, tant il s’apparente au mystère des origines.
Le trouble majeur ne provient-il pas de l’attraction du maternel vers l’unité originelle, vers un singulier qui le détacherait de la condition humaine ? Par sa toute-puissance créatrice, le maternel est suspect et fait peur. Mais plus encore, il est instable, malléable, protéiforme et ses différentes transformations et représentations sont autant d’ombres projetées. Le maternel, à la jonction du corporel et du psychique, du sauvage et du civilisé, du pur et de l’impur, de la vie et de la mort, connaît aussi la possession et la dépossession, le plein et le vide, l’étrange et le familier.
Journée d’études de l’AFPEC « Devenir mère, rester femme »
3 mars 2018
Bibliographie :
- S. Freud, « La tête de méduse », in Résultats, Idées, Problèmes II p. 49
- S. Freud, La vie sexuelle, p. 126, 127
- S. Freud, Sur la sexualité féminine, p. 142
- J. Lacan, Les formations de l’inconscient, p. 271
- F. Ferenczi. 1932. Confusion de langue entre les adultes et l’enfant, Paris, Payot, 2004.
- J. Lacan, « Le Malentendu », in Ornicar, 1980.
- P. Lacadée, Le malentendu de l’enfant, Editions Payot Lausanne, 2004, p.208
- J. Kristeva (1980), Pouvoirs de l’horreur, Paris, Points Seuil, p. 94.
- F. Dolto, (1984). L’image inconsciente du corps. Paris, Le Seuil.
- S. Freud (1910), Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, ocf.p, X, Paris, puf, 1993.
- P. Fédida (1980), L’arrière-mère et le destin de la féminité, Psychanalyse à l’Université, n° 18 ; repris dans Mères et elles, la menace de l’identique, Paris, puf, 2003
- I. Barande (1977), Le maternel singulier, Paris, Aubier
- M.Klein (1932), La psychanalyse des enfants, Paris, puf, 1959
- S. Freud (1905), Trois essais sur la vie sexuelle, ocf.p, VI, Paris, puf.
- J. André (1999), Introduction, les baisers, La folie maternelle ordinaire, Paris, puf, 2006 et (1999), La féminité autrement, Paris, puf.


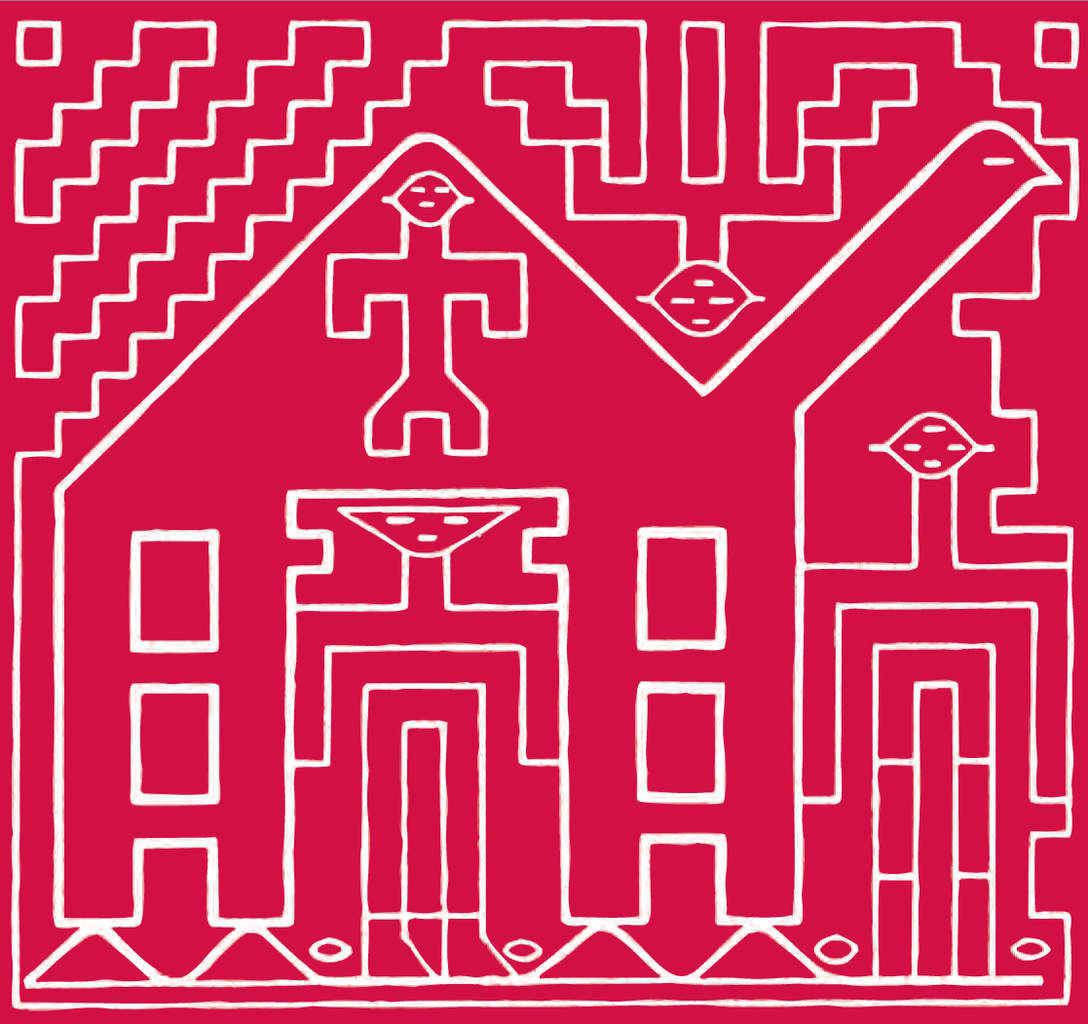
Laisser un commentaire