Chaque rencontre,
avec un patient c’est une rencontre avec une histoire familiale, culturelle, trans-générationelle. C’est une rencontre avec le temps de l’autre, son engagement, son tempo, son rythme et la spécificité de son vécu. Après ce moment-là, de la rencontre vient le temps du lien et du transfert, sans lequel aucun travail ne peut se faire. Cette rencontre est particulière, car la personne qui vient nous voir et qu’on accueille, vient nous transmettre quelque chose de son vécu, de son être, de son rapport à l’autre et au monde. La question que je me suis posée ici, et à laquelle je vais tenter de répondre est la suivante : est-ce que le transfert est une forme de transmission ? et comment ? Montaigne disait« la parole est à moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l’écoute »
Dans le mot « transfert » et le mot « Transmission », il y a quand même un préfixe en commun qui est « trans » qui montre bien qu’il s’agit d’un franchissement, d’un accès, un passage d’un point A à un point B, d’un professeur à un élève, d’un analyste à un analysant, d’un médecin à un patient, etc.
Cette brèche qui s’ouvre pour laisser place à un échange, ne devient possible qu’avec la transmission et le transfert qui est un échange à double sens.
A la première page de son ouvrage « jeu et réalité » Winnicott a écrit « à mes patients qui ont payé pour m’instruire » Les patients viennent nous apprendre des choses sur eux, sur leur vérité et sur nous-même aussi.
Lors de sa proposition du 9 octobre 1967, Lacan commence son discours avec ceci : « au commencement de la psychanalyse, est le transfert » en référence avec le premier verset de l’évangile « au commencement était la parole ». [1]« La notion de transfert chez Freud recouvre bien un processus de transmission, puisqu’elle désigne un mouvement de transport, de déplacement d’un lieu vers un autre. »
Je vais vous faire part d’un échange avec un patient qui est venu me voir 3 fois. C’est un homme de 40 ans, il fait 1m 90 à peu près, quelques tatouages visibles qu’il essaye de dissimuler, un regard vif et poignant.
Trahi par son ami et associé, il s’est fait arrêter pour une histoire de chèque sans provisions.
Assis en face de moi, il me fixe du regard et me dit : « est ce que je vous fais peur madame ? »
J’ai mis un peu de temps pour répondre, pas pace que sa question m’avait surprise, au contraire parce qu’il avait vu juste, il était vrai qu’il me faisait un peu peur, son allure, son histoire de prison.
Je me suis senti même « imaginairement » en danger.
Même si rien, de ce que j’ai pu dire, ou faire ne pouvait montrer quoique ce soit de ma crainte, il y avait quelque chose qui a été transmise.
Dans une rencontre on transmet à son insu une énergie, un affect, une représentation, un sentiment, l’imaginaire peut s’emballer.
Mais dans une rencontre avec un patient, même si tout cela peut être activé, il ne s’agit pas de nous ! c’est de lui qu’il s’agit.
je lui réponds alors par une question.
– est ce que vous pensez que vous faites peur ? »
– peut être qu’inconsciemment je peux faire peur pour me protéger ; mon corps ne m’aide pas, me dit-il je suis assez imposant, et je pense que j’en rajoute aussi beaucoup pour accentuer ça,
L’entretien s’est poursuivi dans ce sens, en parlant de sa peur, ses angoisses et de ce besoin qu’il a de se protéger des autres, des trahisons, des blessures, quitte à faire peur.
Une lueur d’émotion est apparue, et cette crainte que j’avais au début a disparu pour laisser place à un affect. Il a continué à venir me voir pendant une année et je ne pense que s’il ne m’avait pas touchée, je n’aurais pas pu faire un bout de chemin avec lui,
on ne peut pas parler de transfert, sans parler de contre transfert qui n’est en réalité comme disait Lacan que « le transfert de l’analyste » et qui se produirait dans un registre imaginaire, plus spécifiquement spéculaire. une sorte de capture imaginaire se produisant chez l’analyste dans la sphère de son moi.[2]
Le moment de l’entretien, c’est un moment de vérité. D’une vérité qui est liée à ce qui se passe dans la réalité de la scène. Le transfert n’est pas seulement une réplétion aveugle,
c’est aussi un moment de création.
Mais qu’est-ce que c’est le transfert ?
Pour le définir on peut dire que c’est la projection, par le patient(e) de contenus inconscients sur la personne du psychanalyste, mais c’est avant tout un phénomène humain qui n’est pas exclusif à la relation analyste analysant. Bien avant Freud en 1834 le physiologiste
E.H. Weber, percevait « le transfert » comme un phénomène qui faciliterait une activité. Le génie de Freud n’était pas juste dans le fait de décrire ce phénomène, mais de le théoriser de l’analyser et d’en faire la pierre angulaire de la cure, et son moteur.
Pour Freud le transfert était d’abord un phénomène ensuite un concept ; il le décrit comme une forme de résistance.
Ce mot de résistance est apparu dans l’interprétation des rêves qui traduit tout processus d’interruption de la cure analytique, « tout ce qui détruit, suspend, altère la continuation du travail analytique est une résistance »[3]
depuis le « cas Dora » jusqu’au « l’homme aux rats » : cela va de l’interruption prématurée du traitement au transfert dit « négatif » ; Mais avant cela, depuis ces premiers patientes hystériques Freud était très attentif à ce qui se déroulait dans les mouvements transférentiels, il cite cet exemple « Chez une de mes patientes, un certain symptôme hystérique tirait son origine du désir éprouvé longtemps auparavant, mais aussitôt rejeté dans l’inconscient, de voir l’homme avec qui elle avait conversé, la serrer affectueusement dans ses bras et lui soustraire un baiser. Or, il advient, à la fin d’une séance, qu’un désir semblable surgit chez la malade par rapport à ma personne ; elle en est épouvantée, passe une nuit blanche et, à la séance suivante où, cependant, elle ne refuse pas de se laisser traiter, le procédé reste entièrement inopérant » Ce que Freud nous explique suite à cet exemple ; c’est que la patiente était consciemment coopérante mais ce n’est pas pour autant que le procédé thérapeutique et de soin ait marché. Quelque temps après, la patiente avoue à Freud ce qu’elle a pu ressentir et le travail a pu continuer. Ce qui est crucial et malheureusement certains « psy » l’oublient ou font semblant d’oublier c’est que cet amour de transfert, ce que la patiente a ressenti n’est pas adressé au psychanalyste ou au médecin mais ce n’est qu’un déplacement d’un autre amour lui-même refoulé. A aucun moment, ce que le patient ressent d’amour ou de haine n’est pour la personne de l’analyste et si Freud n’avait pas interprété les choses ainsi, la psychanalyse n’aurait pas pu avoir lieu.
La résistance qu’il voit apparaitre vient de l’inconscient, et cet inconscient lui-même responsable du transfert ; pour Freud, le parallèle est simple
e transfert trouve son origine dans l’inconscient, il ne peut donc être qu’une répétition de l’inconscient et consolide le concept du transfert au tour de l’amour, si le transfert est positif et au tour de la haine si le transfert est négatif.
le transfert est donc un lié à l’amour, l’amour de la répétition, qui est liée à l’œdipe. Toujours dans la pensée de Freud dans une cure il faudrait donc selon lui ré-envoyer le patient à son amour refoulé pour ses parents afin de dénouer une résistance s’il y’-en a, fluidifier le transfert et poursuivre le travail de la cure. Après l’échec de cure de Dora, il nous dit que « le transfert destiné à être le plus grand obstacle à la psychanalyste devient son plus puissant auxiliaire si l’on réussit à devenir à chaque fois et à en traduire le sens au malade »
En 1951, dans « Interventions sur le transfert » Lacan explique que le transfert est une expérience dialectique qui permet des remaniements, des évolutions et un travail inconscient ; Il le définit « comme les modes permanent selon lesquels le sujet constitue ses objets » ; comme il y a des modes permanent il y aurait toujours quelque chose à répéter.
- Je vais vous faire part d’une autre bribe d’histoire, celle de S., un jeune homme de 20 ans qui fait des études de Beaux-arts, il était venu me voir suite à des crises d’angoisses répétitives et des tentatives de thérapie sans succès. Toutes les séances démarraient avec un « je ne sais pourquoi je suis là, je ne sais pas si ça sert à quelque chose » et souvent une odeur forte et quelque fois nauséabonde. L’état d’angoisse dans laquelle il était et cette odeur, envahissaient tellement la pièce, que ça me provoquait parfois une quinte de toux ; il me fallait un effort et une énergie colossale et épuisante pour ne pas arrêter cet engagement et continuer à l’accueillir.
C’était agressif certes, mais est-ce que cette agressivité était nécessaire ? que voulait elle dire ? à qui s’adressait-elle ?
Il était clair qu’il fallait l’amener à parler de son corps, puisqu’il était à ce point présent via cette odeur. …
Cela n’était pas évident…. Il fallait qu’un jour j’inonde la pièce avec du parfum, un autre avec un parfum d’ambiance, une fois une bougie qui sentait fort. Jusqu’au jour où il a pu enfin dire le mal qu’il n’avait jamais pu dire, et c’était une histoire d’attouchement avec un cousin qui a duré de ses sept à ses douze ans.
Il y a eu un avant et un après dans le travail avec ce patient après cette révélation, la question de l’odeur et de l’agressivité a pu être travaillée dans le transfert.
Aujourd’hui, cette odeur n’est plus d’actualité et ce n’est pas parce qu’il sent bon qu’il est sorti d’affaire, moi je dirai que ça nous permis de faire affaire avec le transfert qui nous aide à avancer. Ici ou ailleurs Le transfert doit être compris dans une dynamique dialectique, dans son texte « La dynamique du transfert » Freud précise que « si le transfert est le facteur le plus efficace de réussite, c’est aussi le plus puissant agent de la résistance » comme il peut être un moteur, il peut être un frein il faut donc apprendre à mesurer les effets, en soi d’abord pour s’en servir.[4]
Dans Cinq leçons sur la psychanalyse Freud explique bien ce qui se passe
Freud a essayé de schématiser que ce qui passe dans le transfert
« … c’est un fragment de vie affective dont le patient ne peut plus se rappeler …
le patient le revit dans ses relations avec le médecin ; et ce n’est qu’après une telle reviviscence par le transfert qu’il est convaincu de l’existence comme la force de ses mouvements sexuels inconscients. Les symptômes, qui, pour emprunter une comparaison à la chimie, sont les précipités d’anciennes expériences d’amour (au sens le plus large) ne peuvent se dissoudre et se transformer en d’autres produits psychiques qu’à la température plus élevée de l’évènement du transfert, dans cette réaction le médecin joue selon l’expression de Ferenczi, le rôle de « ferment catalytique » qui attire temporairement à lui les affects qui viennent d’être libérés. »[5]
Le transfert c’est de l’amour, qui, sans haine, ne servira pas à grand-chose.
Mais l’amour de qui ? Et de quoi ?
En 1960, Lacan revient avec un séminaire sur le transfert avec une innovation, qui rompt avec la répétition comme l’unique procédé du transfert.
Selon lui, le transfert est l’un des concepts fondamentaux de la psychanalyse avec l’inconscient, la pulsion et la répétition il le définit comme « la mise en acte par l’expérience analytique de la réalité de l’inconscient »
Dans la rencontre analytique et dans une cure, il y aurait un déplacement de signifiants, la personne qui vient nous voir vient nous apporter ses maux, son vécu, ses mots et ses symptômes, avec un corps qui fait partie intégrante de la cure, comme c’était le cas le Selim que je viens de citer. Pour Lacan le transfert concerne la croyance selon laquelle l’analyste est perçu comme celui qui sait tout ; et tout de de lui, celui qui ne connait pas la castration et qui aura la clés et les solutions à tous ses problèmes.
Le « j’aime mon psy » de Freud devient chez Lacan « je l’aime parce qu’il sait ». « Le transfert c’est de l’amour qui s’adresse au savoir »[6]
Lacan conclu, que le transfert c’est de l’amour certes, mais de l’amour adressé au savoir
il ne s’agira pas uniquement de répétitions infantiles ce que Lacan appelle (transfert imaginaire ( ou alors du seul rapport du sujet au signifiant ce qu’il l’appelle transfert symbolique, le transfert met en jeu un réel ( transfert réel. L’analyste intervient par sa parole par sa présence.[7]
Dans une anecdote, pour illustrer ses propos Lacan disait qu’on n’avait jamais vu un patient dans un moment de régression chier sur le divan de l’analyste.
C’est un exemple extrême certes mais qui montre bien qu’il ne s’agit pas d’une simple et unique répétition, le psy n’est pas le père ou la mère ou l’agresseur mais il est mis à la place de … c’est ça le déplacement et le transfert.
Dans le transfert il ne s’agit pas de « nous, » le psychanalyste prête sa personne pour que l’analysant puisse avoir un support pour son transfert, pour illustrer mes propos, (une patiente me disait un jour qu’elle est allé voir un psychiatre et ce qui l’a dérangée c’est qu’elle n’a rien senti, il était tellement distant et froid me disait-elle, on dirait que sa blouse blanche cachait tous ses sentiments. Se prêter comme support pour que le transfert, fasse son chemin n’est pas chose facile et évidente.
La personne qui s’adresse à un psychiatre, un psychanalyste ou un psychologue, va mettre la personne du psy dans cette place de l’autre, cet Autre à qui il parle, c’est un destinataire précieux, c’est un lieu de la parole et ce trésor des signifiants, de l’inconscient, et c’est à ce moment-là de cet appel où la personne s’adresse à cet Autre du savoir que le transfert s’active.
La réponse à cet appel est certes importante et ce qui est le plus important c’est à quelle place, il va répondre ? le travail à faire c’est de savoir comme disait Lacan dans quel discours l’analyste est pris ? à quelle place le patient a pu le mettre ? cette étape est cruciale car l’analyste doit supporter ou du moins essayer de supporter le transfert dans une position que Lacan appelait « semblant d’objet » et cela pour permettre au patient de comprendre et de saisir la logique de ses répétitions aussi bien dans le mouvement transférentiel que dans la vie.
En prenant l’exemple du Banquet de Platon, dans son séminaire, « le transfert », Lacan montre que Socrate a été dans une position semblable à celle du psychanalyste. Brièvement. Dans une soirée ou tout le monde jouait à faire l’éloge du dieu AMOUR, Alcibiade lui fait des éloges à Socrate. Il lui déclare sa flamme et le compare à un objet précieux appelait AGALMA.
Face à cette déclaration, Socrate se soustrait de cette position de l’objet d’amour et de désir comme dans une situation analytique, ou l’analyste s’abstient et se soustrait pour laisser la place au patient pour faire son travail aller vers sa connaissance sa vérité et découvrir son propre objet précieux et à la fin de cette scène, Socrate effectue un autre renversement comme l’aurai fait un psychanalyste ou il a répondu à Alcibiade que tout cet amour ne lui ai pas adressé mais qu’il est adressé à Agathon. Comme le ferait exactement un psychanalyste qui ne va prendre cet amour pour sa propre personne et qui va prendre appui sur ce transfert pour avoir accès à la vérité du patient.
Avant de conclure je vais de vous raconter une autre bribe de cure avec une patiente :
Inès 30 ans, je suis peut-être la cinquième psy qu’elle consulte, à chaque fois elle interrompt brusquement soit parce qu’on devient amies me dit-elle soit parce que je ne les aime pas.
Elle venait toujours avec 10 -15 minutes de retard, des fois, elle oubliait son portefeuille chez elle, si elle venait à l’heure et n’oubliait pas son argent, elle essayait d’être un peu familière
(le tutoiement par exemple). Un jour, je lui donne rdv un vendredi matin et c’est moi qui arrive en retard de 10 minutes. Elle était effondrée, je me suis excusée et elle me dit finalement « c’est pas cool alors de vous laisser attendre à chaque fois. »
Ce qui s’est passé, a permis à Inès d’associer avec un souvenir enfoui, de toutes les fois où elle devait attendre sa mère devant l’école. « elle était débordée avec tout ce qu’elle avait à faire, ça lui arrivait souvent de m’oublier et j’attendais avec le gardien.. »
Dans l’après coup, je pense que même son retard était lié à mon contre transfert.
Pour André Green c’est tout le fonctionnent psychique de l’analyste qui est impliqué dans le travail de la cure, « ce qui est demandé à l’analyste c’est plus que ses capacités affectives et son empathie, en fait c’est son fonctionnement mental, c’est ici que le contre transfert reçoit sa signification la plus étendue »[8]
Elle m’a transmis quelque chose et je l’ai reçu, cette chose-là qui a pris une forme d’agressivité inconsciente ou d’attaque au cadre, avec Inès ou avec Selim via l’odeur qu’il dégageait, ce n’était pas uniquement de la destructivité ; ce qui est important à relever, c’est surtout l’urgence de voir ma capacité à supporter, ma solitude à faire face à cette destructivité inconsciente du lien et de l’autre. Aussi bien le transfert que le contre Transfert peuvent être une forme de résistance ou un allié à la cure, si l’analyste n’est pas capable de gérer son propre transfert, s’il n’est pas en mesure de mettre les parures de son être entre parenthèses.
Et s’il n’est pas capable de soutenir cette place « désubjectivisée » dans laquelle pourrait se déployer le transfert du patient, aucun travail ne peut se faire.
Pour conclure je dirai qu’on ne peut pas parler de transfert sans transmission ;
On est parent parce qu’on a été les enfants de nos parents, on est analyste parce qu’on a été analysant, on transmet des émotions, des valeurs, des affects, parce que on nous les a transmis. Winnicott avait écrit un poème qu’il l’a intitulé Arbre, où il avait écrit
« Mère est en larmes. En larmes, Ainsi l’ai-je connue ; Autrefois, allongé sur ses genoux ; Comme un présent sur l’arbre mort ; Je lui apprenais à sourire, À contenir ses larmes,
À se défaire de sa culpabilité, À soigner sa mort intérieure.
Je gagnais ma vie à La rendre vivante »
Tout ce que sa mère a pu lui transmettre, Winnicott en l’a transformé et il en a fait une œuvre singulière et qui reste une référence aujourd’hui.
Qu’on nous transmette un héritage, des gènes, des secrets de familles, des traumas, de la haine ou l’amour ou une maladie ; cette transmission fera partie d’une empreinte, celle de chacun de nous. Freud disait qu’il y avait trois métier impossible : Guérir, éduquer et gouverner moi j’ajouterai que si on pouvait transmettre quelque chose de l’amour du savoir ou du désir cela peut devenir possible.
[2] Les lettres de la S.P.F, n 17,2007, p18.
[3] Lacan, J., Les Ecrits techniques de Freud.
[4] Joseph Rouze, « LE TRANSFERT ET SON MANIEMENT DANS LES PRATIQUES SOCIALES. », janvier 2003.
[5] Sigmund Freud « cinq leçons sur la psychanayses » p. 61.
[6] Lacan J., « Introduction à l’édition allemande des Écrits », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 557-558.
[7] Joseph Rouze, « LE TRANSFERT ET SON MANIEMENT DANS LES PRATIQUES SOCIALES. », janvier 2003
[8] André Green, la folie privée, paris Gallimard, p.74 « souvent il arrive que l’analyste ressente des impression encore moins nettes, qui ne prennent ni la forme d’images ni celle de souvenirs de moment antérieurs de la cure,, celles-ci paraissent reproduire par l’expression de mouvement internes, certaines trajectoires de motions pulsionnelles, donnant des sensations d’enveloppement et de développement, un travail intense se fait sur ses mouvements qui parvient à les rendre communicable à la conscience de l’analyste, avant qu’il puisse les transformer comme par une mutation interne, ces contenus en séquences de mots par la verbalisation qui va servir à en faire part au patient au moment venu ; le trouble affectif a laissé place à une construction il y’a transformation de l’informel en une forme qui fait sens »


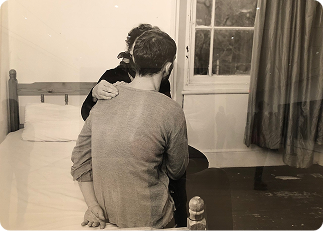
Laisser un commentaire