J’ai demandé à un petit garçon de 10 ans : « Est ce que tu sais ce que c’est une qu’une sorcière ? » et voici quelle a été sa réponse : « Quoi ? tu ne sais pas ce qu’est qu’une sorcière ? bah c’est facile, une sorcière c’est une femme qui déteste les enfants ».
« Ah bon ? Et pourquoi pense-tu qu’elle déteste les enfants? » ; « Mais, c’est parce qu’elle est jalouse d’eux ! », m’a t il répondu. Sa petite sœur, âgée de 6 ans écoutait la conversation en silence.
Je me retourne vers elle et je lui demande : « Et toi ? est ce que tu sais ce que c’est une sorcière ? ».
elle me répond : « bah oui, fastoche, une sorcière c’est une femme méchante qui a une baguette magique ».
« Mais ma chérie, est ce que tu confondrait pas la sorcière avec la fée ? » ; elle prend son temps pour réflechir : « Euh je ne sais plus… mais tu sais, il y a des sorcières qui sont gentilles aussi» ; Je vois que la question la travaille, elle va dans sa chambre puis revient avec un livre d’histoires et me montre des sorcières affairées à fabriquer des potions magiques autour d’un chaudron : « Regardes, les sorcières, elles sont dans le livre, elles ne sont pas méchantes, elles ont un pouvoir magique ».
Pour les enfants, les choses semblent claires, en tout cas, bien plus claires qu’elles ne le sont pour moi.
Ils savent situer les sorcières là où elles sont, dans les livres de contes, c’est à dire dans l’imaginaire.
Ils savent aussi qu’il n’y en a pas dans la vie réelle, que « c’est pas pour de vrai ».
Mais pour moi, je dois dire que les choses sont loin d’être aussi évidentes.
Et c’est pourquoi, je viens vous parler des sorcières aujourd’hui. Parce que je ne sais pas où les situer, moi, les sorcières.
J’ai donc écris ce texte pour essayer de marcher sur leurs traces, toujours selon une lecture psychanalytique, mais cette lecture, vous allez le voir se fonde essentiellement sur la question du fantasme, au sein de ce que l’on appelle « l’inconscient collectif ». Pourquoi les sorcières et quel lien avec le thème de notre journée ? Le devenir mère, mais aussi le devenir femme, nous le savons s’inscrivent dans un processus qui n’est pas sans difficulté. La figure de la sorcière représente donc tout ce qui peut avoir attrait à l’impasse de la féminité et de la maternité, mais aussi à ce qui peut en découler de menaçant. Elle s’inscrit en négatif de la mère idéalisée mais aussi de la femme aimante. La sorcière, c’est cette femme pour qui les liens d’amour ont été entravés. La sorcière, c’est cette femme de l’ombre qui git peut être en nous et qui serait prête à surgir si elle se sent menacée. La sorcière, c’est cette femme qui fait peur aux enfants mais aussi aux hommes.
C’est cette femme blessée et aigrie qui incarne la vanité et la rancœur, source de bien des maux et de bien des difficultés dans une vie.
Que ce soit une femme trompée par son mari, une femme abandonnée, une femme sans enfants ou une femme qui ne lâche pas ses enfants, elle est toujours un peu présente dans notre esprit et parfois un peu trop jusqu’à en devenir envahissante comme dans « les délires de sorcellerie ».
Mon objectif, vous l’aurez sans doute compris, est d’explorer la signification psychologique de ces différentes figures de mères-femmes qui se rencontrent sous les formes les plus variées.
De fait, la figure de la mère joue un rôle important dans les périodes de transition – comme aujourd’hui en Tunisie – dans la vie non seulement des individus, mais aussi dans celle de la collectivité. Elle peut prendre la forme d’états de possession collective (comme l’illustre le concept de « Omma islamiya »), mais elle également approter du renouveau à travers la force créative. De cette force créative et créatrice naissent les individus les plus aptes à advenir en tant d’Êtres, c’est à dire à parvenir à une attitude spirituelle et personnelle. Mais s’ils échouent, ils restent bloqués et l’expression de leur talent créateur leur reste inconsciente. Aujourd’hui en Tunisie, après la révolution, on nous a dit libérés d’un près à l’autorité abusive et répressive. Est ce un hasard si dans le discours populaire, on le dit avoir été trompé et dupé pour ne pas dire ensorcelé par sa femme? N’est ce pas du côté maternel que nous devons nous tourner aujourd’hui pour nous reconstruire ? Sommes nous fusionnellement attachés à notre Mère-patrie au point de baigner dans un marasme qui nous fait couler chaque jour un peu plus ? beaucoup vous dirons que oui. Quant à moi, je me demande : qu’en est il de nos forces créatrices, peuvent elles nous mener vers l’émancipation ? Comment devenir mère et rester femme, voici la question qui nous est posée aujourd’hui.
Je me permets de la déployer autrement : comment devenir femme avant de devenir mère ? Une femme peut elle prendre le temps d’advenir en tant qu’individu avant de créer et de procréer ? Inconscient collectif, archétype et contes de fées: Comme je le disais, en m’appuyant sur la psychanalyse, c’est surtout sous l’angle du fantasme que j’adorderai la question, car qui peut dire que les sorcières existent vraiment ? Et pourtant ! Selon Freud, le fantasme a sa correspondance dans les mythes et il n’y a pas d’autres moyens de poser correctement le problème du fantasme que sous l’angle de l’anthropologie et donc des mythes ; Pour mieux comprendre, décortiquons un peu les choses et pour cela, je vous propse de nous référer à Jung. Jung parle d’inconscient collectif qu’il oppose à l’inconscient personnel.
Il dit : « j’ai choisi le terme collectif, parce que cet inconscient n’est pas de nature individuelle mais universelle : par opposition à la psychée personnelle, il a des contenus et des modes de comportement qui sont – CUM GRANO SALIS – les mêmes partout et chez tous les individus. » Puis d’inconscient collectif, il élabore la notion d’archétype. Ce que nous dit d’intéressant cette notion, c’est que « dans les contenus inconscients collectifs, nous avons affaire à des types anciens, ou mieux encore originels, c’est à dire à des images universelles présentes depuis toujours (…) toutefois, ce ne sont plus ici des contenus de l’inconscient, mais des archétypes, qui se sont déjà transformés en des formules conscientes enseignées traditionnellement ».
Ces formules sont enseignées traditionnellement, c’est à dire, à travers les mythes et les contes, toujours transmis avec une emprunte spécifique, au fil du temps. Pour lui, ce sont donc les contes de fées qui expriment le mieux et de façon extrêmement sobre et direct les processus psychiques de l’inconscient collectif.
Les archétypes y sont représentés dans leur aspect le plus simple, le plus dépouillé, le plus concis. Dynamique fantasmatique et investissement pulsionnel Jung attribue une signification relative à la mère personnelle, ce qui lui importe avant tout c’est l’archétype projeté sur la mère. Pour appuyer ses propos, il fait référence à Freud, qui, dit-il a reconnu lui-même que l’étiologie des névroses ne prend pas véritablement racine sur les événemenets traumatiques mais bien plutôt sur une évolution particulière des fantasmes infantiles. Quant à Melanie Klein, elle décrit l’enfant au début de sa vie, vivant une position schizo-paranoïde. Le jeune enfant introjecte son environnement, selon deux modalités : amour et haine.
De là, il se crée des imagos, qui sont des représentations psychisées de ce qu’il éprouve face au monde : il y a donc des imagos positives et des imagos négatives. Melanie Klein ajoute que ces imagos sont étroitement liées au vécu que l’enfant éprouve par rapport à sa mère : le sein qui comble et qui nourrit devient le « bon sein », imago positive ; tandis que le sein qui frustre, qui se refuse, qui se sépare, est le « mauvais sein », imago détestable. Le fantasmes de la sorcière La mère et l’état d’envoûtement : Le phénomène multiforme que Jung nomme « complexe mère », ressemblerait à un état d’envoûtement que subissent des êtres humains pris par leur véritable mère et surtout par l’archétype de la mère.
C’est de cet archétype que la véritable mère tire son pouvoir d’envoûter son enfant. La mère détient d’autant plus ce genre de pouvoir quand elle est elle-même possédée par l’archétype de la mère, de sa propre mère. Pour dire les choses autrement, il s’agit des différentes formes de liens d’emprise maternelle. La mère n’est elle pas celle qui sait tout ? Ce qui est bon et ce qui n’est pas bon pour ses enfants, ce qu’il leur faut.
Si on la contrarie ou la fâche, c’est Dieu qu’on fâche: « Al Janatou tahta akdem el omahet » ; Entendez par là : « l’entrée au paradis dépend de la bénédiction maternelle ». Son pouvoir est immense et sa colère est grande. Sacré et sacrillèges entourent et protègent la mère. Et c’est peut être seulement dans le cabinet d’un psychanalyste et sous le sceau de la confidentialité et de la neutralité, que l’on entend parler d’elle autrement que d’un être sanctifié. « Mère nourricière – mère sorcière » : Ces deux expressions paraîssent antagonistes mais révèlent en quelque sorte, dans leur conjonction l’essence même de la représentation maternelle.
La mère nourricière serait cette femme bonne envers son enfant, la mère sorcière, serait, quant à elle, la marâtre, cruelle, voire cannibale qui peut aller jusquà dévorer les enfants. Pourtant, les deux peuvent former un seul et même personnage ambigû aux pouvoirs bienfaiteurs et destructeurs à la fois. rappelez vous la petite fille de 6ans qui me disait que les sorcières sont gentilles, sa confusion n’est pas anodine et la question de la tentation est toujours au cœur du problème.
La sorcière puise donc son pouvoir dans les pièges et artifices qu’elle offre à l’autre pour le séduire. C’est parce que Blanche-Neige accepte la pomme de la vieille femme sorcière qu’elle tombe dans un profond sommeil. Analyser la dynamique fantasmatique nous amène à exlplorer cette fonction nourricière qui se déploie dans un double sens : « nourrir pour avoir de quoi se nourrir » et peut représenter un retour rassurant ou menaçant au sein maternel dans une symbiose mortifère. Jean Bellemin-noêl écrit dans Les contes et leurs fantasmes : « il s’agit de créer une dépendance jusqu’à vouloir dévorer, jusqu’à vouloir récupérer l’autre intégralement.
Dévorer pour ne pas risquer de perdre, de voir l’autre nous échapper ». Avaler ses enfants, c’est les réintégrer, versant négatif et thanatique de l’acte érotique de donner naissance. Il s’agirait ici de l’agressivité maternelle que l’enfant pourrait ressentir et peut déployer à travers le conte.
La jalousie n’est pas l’envie : Le conflit entre Blanche Neige et la méchante reine pourrait illustrer un choc entre deux attitudes opposées au sein de la psychée féminine.
Un sentiment positif idéal et une vive tendance égocentrique. L’envie presque mortifaire personnifiée par la reine signe la négation de l’amour, voir même sa destruction.
Ce petit garçon de 10 ans me disait des sorcières qu’elles étaient des femmes jalouses.
Je dirai que bien plus que de jalousie, il s’agit d’envie. Comme des sœurs jumelles, la jalousie et l’envie se ressemblent beaucoup, mais chacune recouvre une réalisé différente.
Mélanie Klein écrivait à ce propos que l’envie « n’est pas seulement le désir de posséder, mais aussi le besoin impérieux de détruire la jouissance qu’un autre pourrait trouver auprès de l’objet convoité : un tel objet tend à détériorer l’objet lui-même ». De fait, “l’envieux” cherche l’extermination de l’autre.
La jalousie comme conflit pourrait aider une personne à se développer et pour cela elle doit devenir consciente de son égocentrisme.
Si la propension à la jalousie reste inconsciente, une personne ne peut progresser. L’ensemble du conte de blanche Neige illustre un processus de développement des sentiments grâce auquel l’être prend douloureusement conscience de ses contradictions.
Certaines mères semblent avoir fait l’impasse sur leur féminités. Des femmes difficiles à aborder, des femmes « phalliques ».
Il n’y a pas de place pour un homme dans leurs vies (et cela même si elles sont mariées ou mères). Avec ces femmes, gare à la faute, une parole de trop et elles se rebriffent. Des femmes qui s’expriment toujours sur un ton offensé.
Or cette attitude exaspère les hommes. Ce qui les horripile le plus est ce ton sous-jacent de reproches plaintifs.
Cependant, dans la plupart des cas, cette attitude est un appel déguisé à l’amour. Malheureusement, l’effet produit est généralement l’inverse de celui souhaité, car cette attitude de la femme fait fuir l’objet de ses désirs.
Ce ton de reproche traduit en même temps le désir inavoué de rendre ses coups à celui qui l’a blessée. La femme-sorcière agit comme une femme qui exerce un impact inconscient négatif sur les autres parce qu’elle n’arrive pas à assumer ses propres démons, c’est à dire, ses aspects obscurs.
On pourrait dire de ces femmes qu’elles ont sans doute refoulé le côté sorcière en elles. Et de ce fait, elles ne peuvent éviter d’être possédées par ce qui, en elles-mêmes, n’a pas été résolu. Pour conclure, cette question : De quoi manque une sorcière ? On déclare souvent que notre spiritualité s’égare et qu’elle a besoin d’amour pour guérir. Ce n’est pas faux, mais aussi longtemps que l’on méconnait sa part d’ombre, c’est-à-dire aussi longtemps que l’être humain n’a pas fait en lui-même l’expérience de l’ombre, il en demeure prisonnier.
Nombreux sont ceux qui disent qu’on devrait avoir plus d’amour pour ses semblables, et beaucoup sont pleins de bonnes intentions à cet égard. Il ne faut cependant jamais oublier qu’on n’est pas vraiment capable de donner de l’amour quand on ne se connaît pas soi-même.
Enfin, comment ne pas terminer sur cette citation de Lacan : « L’amour, c’est offrir à quelqu’un qui n’en veut pas, quelque chose que l’on n’a pas »…
Bibliographie :
Bellemin-Noël, J. (1983). Les Contes et leurs fantasmes, Paris, PUF.
Bettelheim, B. (1976). Psychanalyse des contes de fées. Paris, Pocket
Birkhäuser-Oeri, S., Van franz, M-L. (2014). La Mère dans les contes de fées. Traduction française de Michel Bacchetta. Paris, La fontaine de Pierre.
Jung, K. (1971). Les racines de la conscience. Paris, Edition Buchet/ Chastel pour la traduction française.
Klein, M. (1968). Le développement précoce de la conscience chez l’enfant. In Essai de psychanalyse, trad. Fr. Marguerite derrida, Paris, Payot.
Klein, M. (1978). Envie et gratitude. Paris, Gallimard.
Valabrega, J-P. Le problème antropologique du fantasme. In Aulagnier, P. et al. (1967). Le désir et la Perversion. Paris. Seuil.
Von Franz, M-L (1970). L’interprétation des contes de fées. Paris, La fontaine de Pierre.


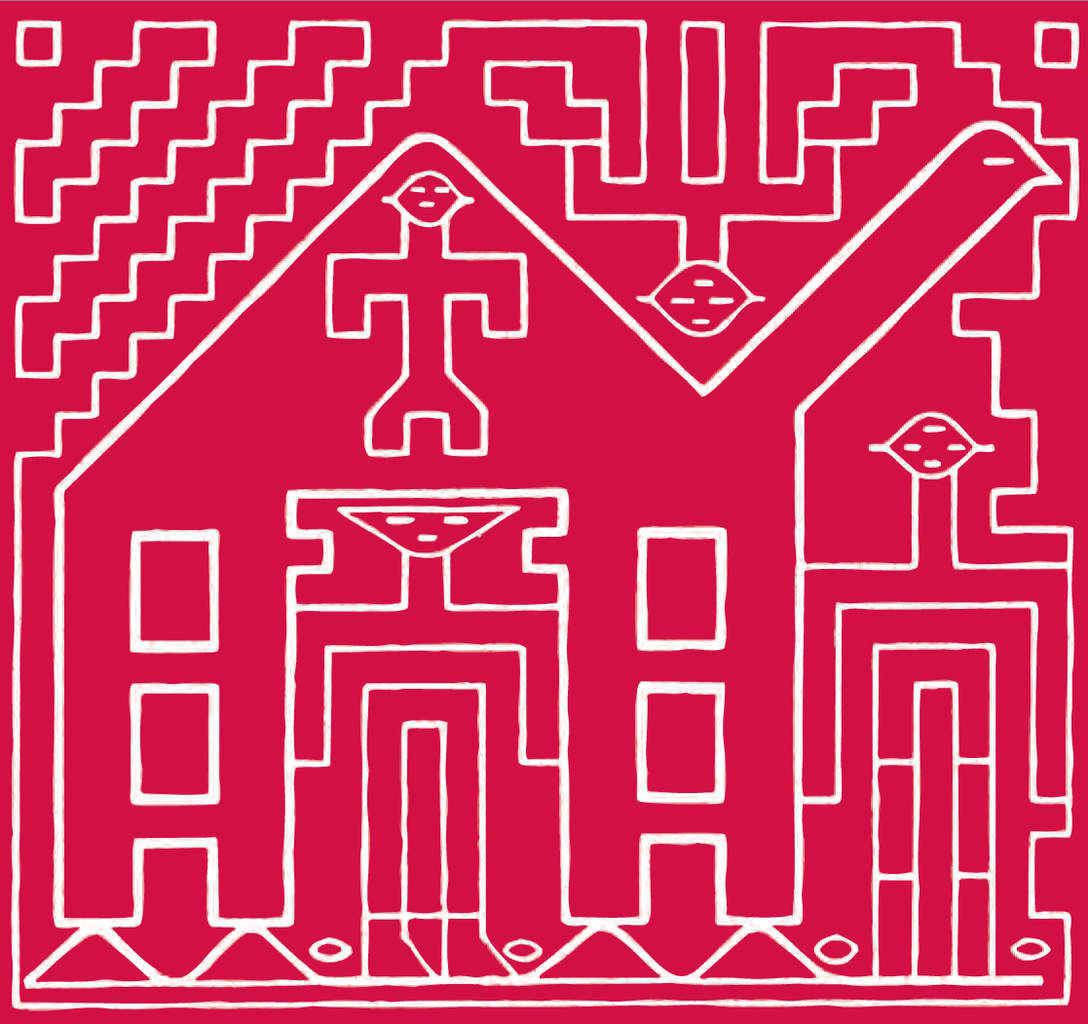
Laisser un commentaire