(suite)
Pour Ferenczi le traumatisme se situe au niveau des « confusions », des intentions dans les jeux de l’adulte avec l’enfant. Aux jeux “tendres” de l’enfant, l’adulte répondrait avec ses “passions » sexuelles. Cette inadéquation donne lieu à des déformations immédiates du Moi. L’enfant, trop angoissé pour pouvoir exprimer sa haine et son refus, s’identifierait à son agresseur. Clivages, fragmentation du Moi, introjection du sentiment de culpabilité de l’agresseur amènent l’enfant à développer une personnalité « as if » (Mahler), un « faux-self » (Winnicott).
L’abandon des frontières physiques et psychiques devient le prix à payer pour l’obtention de l’amour paternel. « Identification à l’agresseur » selon Ferenczi, relation incestuelle d’après Racamier, cette injonction détruit ou rend impossible l’établissement des limites primordiales pour l’instauration du sujet. Lorsqu’il n’y a pas un sujet qui peut dire « je me souviens… », la remémoration est semée de trous noirs. À la place des souvenirs, des symptômes énigmatiques « montrent » la souffrance psychique, tels les patients hystériques à l’époque de Freud.
Les conséquences de cette forme de violence, se manifestent sous des formes variées et changeantes tout au long de la vie des victimes, sans qu’elles puissent établir un lien entre ses maux et les agressions incestueuses : des sentiments de malaise ambigus, des fugues, des symptômes somatiques, des comportements antisociaux, l’addiction à diverses substances, une vie sexuelle chaotique, une accumulation de diverses étiquettes psychopathologiques, …
Ces signes bruyamment muets sont des symptômes au sens propre, qui tentent d’exprimer une vie intérieure parasitée par la pulsion destructrice de l’inceste, mais que l’entourage sait rarement déchiffrer, ou feint d’ignorer. Dans le cas où les souvenirs des scènes incestueuses ont été refoulés pendant une période relativement longue, comme c’est le cas d’Inès, les victimes sont souvent les premières à douter de la réalité : « et puis rien ne s’est passé, rien de grave »…
« Hallucination négative », dirait Sándor Ferenczi, « déni » pour employer un terme freudien. Mais le cœur du problème est plutôt que dans la majorité des cas, ces souvenirs traumatiques sont niés par l’agresseur et/ou d’autres membres de la famille. Faute de trouver une place dans la mémoire familiale, ces souvenirs sont prisonniers d’une mémoire isolée et impartageable. La victime se heurte à un « négationnisme » collectif qui annule toute légitimité de plainte et, dans des cas extrêmes, la pousse à la folie ou la mort.
« Je ne me sépare pas finalement de mon père, je suis cette fessée, je ne suis rien sans cette fessée, je la cherche toujours, je la mérite, ma mère aurait dû me la donner ».
Inès en veut a sa mère de ne pas s’en être rendre compte de ce qui se passait et de ne pas l’avoir punir.
Inès récuse tout forme de discours prétendant que la victime représente un objet de désir pour l’agresseur, « pour lui je n’existe pas, je fais partie de lui. »
Les propos d’Inès expriment un sentiment douloureux d’anéantissement de soi que l’on retrouve chez beaucoup de victimes qui doivent se battre la vie durant pour le droit à une identité propre. Un état qu’Hélène Parat définit comme « appendice narcissique »[16] de l’agresseur. Contrairement au désir du désir de l’Autre qui constitue le sujet parlant, le désir de l’enfant psychiquement parasité, n’a littéralement pas lieu d’être.
Malgré tout, Ines décrit ce trauma d’un amour, comme salvateur, et pour citer Hélène Parat dans « Les confusions incestueuses », « Lorsqu’un père commet un inceste, il entre pour ainsi dire dans la peau psychique de la mère.»
Les extraits d’entretien de Rim et d’Inès permettent d’entrevoir le piège que représente la situation œdipienne pour la victime : espérant obtenir l’amour parental, elle doit obéir aux ordres insensés du parent qui, en retour, détruit la configuration œdipienne dans laquelle aurait dû se réaliser la subjectivation par l’identification (y compris l’identification sexuelle).
L’inceste est bel et bien le contraire de l’œdipe, mais les victimes d’inceste vivent les deux situations à la fois. Le meurtre psychique incestueux expulse le sujet naissant de lui-même pour l’enfermer dans un espace souterrain et sous humain. Il démolit la base de confiance dans l’établissement des liens, rend toute relation érotisée et transforme en même temps tout « autre », non plus en un semblable à moi comme dans le miroir lacanien, mais un envahisseur ou un persécuteur. De ce massacre interne, il est difficile de trouver ou créer un refuge psychique. La famille devient elle-même un lieu de torture.
Bien que le tabou de l’inceste soit nié par l’adulte, il est inscrit, avec une douleur vive, dans la psyché de l’enfant. Leur salut est moins à chercher du côté de la « résilience » des victimes que dans les liens qu’elles ont su nouer à travers des rencontres porteuses de sens et dans leur capacité de créer une filiation symbolique.
Le poème « L’aigle noir » de Barbara a suscité le concept de « résilience » établi par le psychanalyste Boris Cyrulnik.
Un beau jour, ou peut-être une nuit
Près d’un lac, je m’étais endormie
Quand soudain, semblant crever le ciel
Et venant de nulle part
Surgit un aigle noir
De son bec il a touché ma joue
Dans ma main il a glissé son cou
C’est alors que je l’ai reconnu
Surgissant du passé
Il m’était revenu.
Barbara rêve de Barbara, allongée au bord du miroir, elle convie celui qui l’écoute à partager les images nées de son sommeil.
La vision de l’oiseau fait effraction mais à qui, ou à quoi renvoie-t-elle ? À un message sans doute, un langage à déchiffrer. Barbara n’en dira pas plus : « C’est alors que je l’ai reconnu… Il m’était revenu… » Quelle rencontre l’image de l’oiseau commémore-t-elle ? Faudra-t-il se contenter de cette ellipse ? Barbara essaye-t-elle de transformer l’évènement traumatique en création esthétique ? Essaye-t-elle de rétablir le temps de son histoire dans une déconstruction –reconstruction qui suspend l’inceste et restaure l’œdipe ?
Bibliographie :
[2] Barbara, Il était un piano noir, Fayard, 1998, p. 27.
[3] Dr Michel Delbrouck est psychothérapeute, formateur, superviseur. Directeur de l’Institut de Formation et de Thérapie pour Soignants. Membre affilié de l’Institut International de Psychanalyse et de Psychothérapie Charles Baudouin (Genève). Past-Président de la Société Balint Belge Membre titulaire et Vice-Président de la Société Belge de Gestalt. Superviseur agréé et enseignant de l’Ecole Parisienne de Gestalt. Membre de l’Association Européenne de Psychothérapie
[4] P.-C. Racamier, L’Inceste et l’incestuel, Paris, Les Éditions du Collège, 1995, p. 6.
[5] F. Amerongen, « Le désir et ses métamorphoses », Cahiers jungiens de psychanalyse, no 89, été 1997, p. 8.
[6] Barrois(1995), traumatisme et inceste, paris, puf.
[7] Hurni, Maurice et Stoll, Giovanna (2014), Le mystère Freud : psychanalyse et violence familiale, Paris : L’Harmattan, 254 p. (p. 231-232).
[8] P. C. Racamier, « L’incestuel, Vocabulaire de psychanalyse groupale et familiale », Éd. du Collège, 1998.
[9] BALINT M., « Le défaut fondamental » (1968), Petite Bibliothèque Payot, n° 350.
[10] Ferenczi, Sándor, « Confusion de langue entre les adultes et l’enfant » (1932), Bibliothèque Payot n° 521, P .43
[11] C. Dorly, « Inceste et adolescence », Cahiers jungiens de psychanalyse, no 89, été 1997, p. 19.
[12] Ferenczi, S., « Confusion de langue entre les adultes et l’enfant » (1932), Bibliothèque Payot n 521, P 53 .
[13] P.-C. Racamier, L’Inceste et l’incestuel, op. cit., p. 66.
[14] Barrois, (1995), « Traumatisme et inceste », paris, puf.
[15] Ferenczi, S. (1934), « La confusion des langues entre adultes et l’enfants », in Psychanalyse IV, p . 134 .
[16] H. Parat (2004), op.cit, p.84-85.


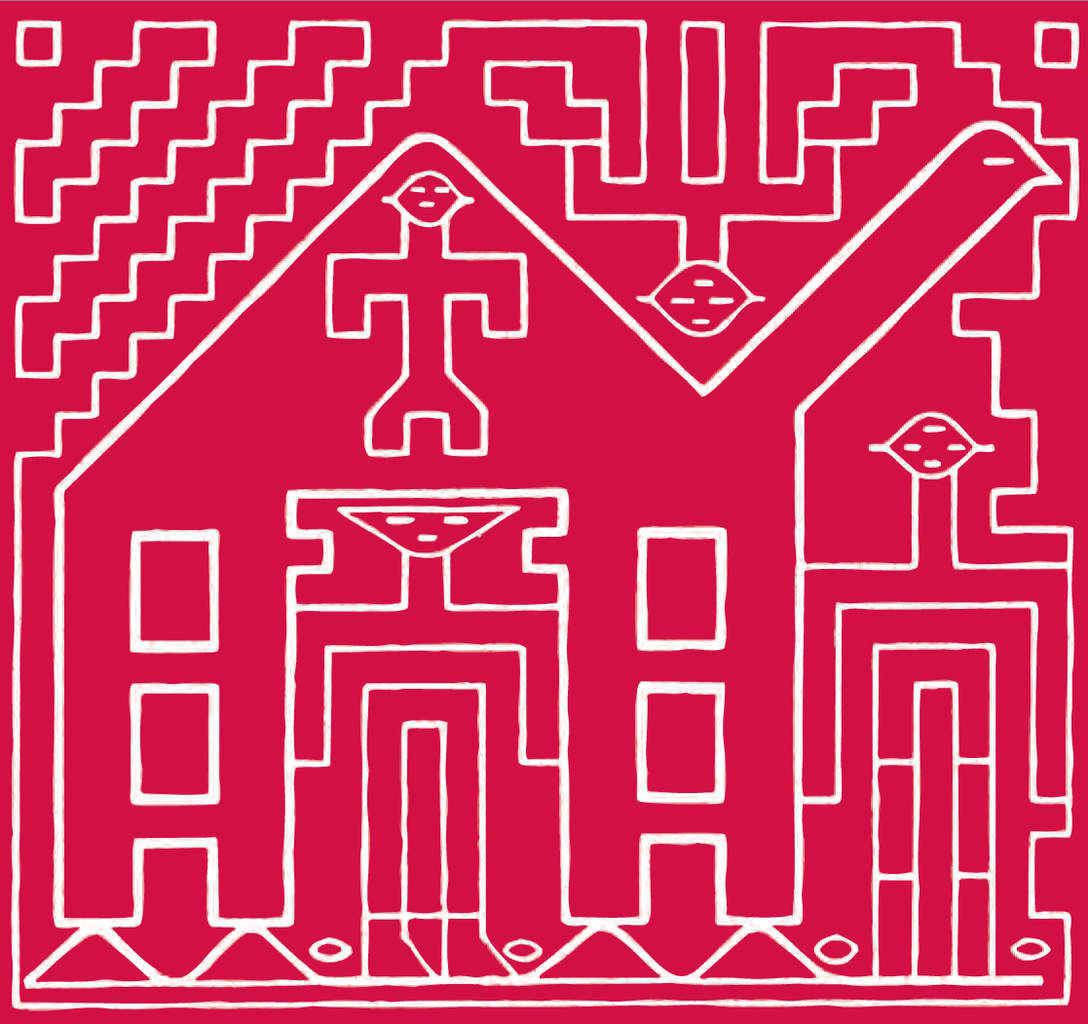
Laisser un commentaire