Sur l’adolescence :
Texte introductif à la journée « L’ado et son psy »,
consacrée à Raymond Cahn et à sa pensée (16 décembre 2018)
Nédra Ben Smail
Ouverture :
Raymond Cahn, vous êtes psychiatre et psychanalyste, ancien président de la Société Psychanalytique de Paris (1980), et ancien-médecin directeur de l’hôpital de jour pour adolescent du Parc Montsouris.
Après des 1ères années à Strasbourg (où Lagache et Favez-Boutonnier enseignaient déjà), dans le service du Professeur Kammerer (psychanalyste), vous décidez en 1952 de rejoindre à Paris ce que vous présentez comme « un homme tout petit qui joue avec les enfants » ; il s’agit de Serge Lebovici.
Entre 1953 et et 1964, vous fréquentez, travaillez, échangez, avec Evelyne Kestemberg, René Diatkine, Jean Favreau, Piera Aulagnier, Lucien Israel, et bien d’autres grands noms de la psychanalyse. Votre pensée est influencée et s’enrichit, entre autres, des travaux de D. Winnicott et Piera Aulagnier.
En 1963, vous montez le CEREP, l’hôpital de jour pour adolescent du Parc Montsouris, qui vous ouvrira un champ d’expériences privilégié pour penser l’institution. On vous doit le concept de subjectivation, notion centrale dans la cure notamment des adolescents, concept introduit dès 1991 au Congrès des Psychanalystes de langue française, ce qui a largement contribué à la divulgation de cette notion de subjectivation.
Vous êtes l’auteur de nombreux ouvrages, notamment « Adolescence et folie », « L’adolescence dans la psychanalyse », « Le sujet dans la psychanalyse aujourd’hui », La fin du divan ? ».
Enfin, vous avez récemment codirigé avec Serge Tisseron et Philippe Gutton, « L’ado et son psy, nouvelle approche thérapeutique en psychanalyse » (Inpress, 2013), « Le Sujet freudien : origine et destin de la subjectivation » (PUF, 2016).
Introduction : sur l’adolescence
La psychanalyse définit l’adolescence comme un temps de rupture avec l’enfance ; un temps où le jeune ne peut plus se permettre d’être enfant, mais craint l’arrivée relativement brutal de l’âge adulte : brutale, parce que ce qui le bouscule, c’est un corps qui change, qui devient pubère qui le contraint à découvrir qu’il est devenu un homme, une femme, c’est à dire qu’il a dorénavant les potentialités d’un adulte du point de vue de la sexualité. Donc en quelque sorte, il doit faire la preuve de son nouveau statut, se positionner en tant qu’individu sexué (homme, femme, ce qui n’est pas donné d’avance), un corps qui s’accélère donc, qui est au-devant de la scène, qu’il faut s’approprier ce qui demande un certain nombre de réaménagements psychiques. C’est le cas de Blanche[1] qui interroge son corps sexué (Qu’est-ce qu’être une femme ?) ; dans un 1er temps, en effaçant tout signe de féminité naissante avant d’adopter l’autre extrême (tenues extravagantes et sexualité débridée), pour tenter de se saisir de son identité, les miroirs lui renvoyant à l’infini son image sans pouvoir la saisir.
Vous écrivez encore à propos de Blanche, « Dans cette quête désespérée d’elle-même, un tel excès dans les conduites, un tel déchainement caricatural, ne donnent-ils pas à penser à (…) une crise d’adolescence pathologique liée à un désarroi profond qu’elle éprouve sur le plan identitaire ? ».
Cet éveil sexuel suscite des fantasmes inconscients qui peuvent être ressentis comme menaçants car ils sont orientés vers les figures parentales qui apparaissent comme individus sexualisés (Maman est une femme, et moi je deviens un homme, donc la situation est dangereuse ; on ne la regarde plus de la même manière). C’est à dire que dans l’inconscient, dans ce moment de transition, ce qui affleurent ce sont des désirs incestueux et parricides, et les violents mouvements défensifs de mise à distance. Certains adolescents peuvent devenir agressifs, ou se retirent dans leur chambre, parce que dans l’inconscient ce n’est pas simple. Le surgissement du pubertaire, et la découverte de l’altérité qui est censé mettre fin au règne du stade phallique et de l’auto-érotisme, sont potentiellement traumatiques pour l’adolescent qui ne trouve pas les ressources symboliques pour élaborer ces changements et assumer la rencontre du féminin en soi : cette rencontre le contraint à des questionnements sur son orientation sexuelle.
C’est grâce à cette mise à distance, et à l’interdit de l’inceste qui aura été plus ou moins bien symbolisé, que l’adolescent va aller « regarder au-dehors dans le monde réel », c’est-à-dire qu’il va construire sa présence au monde, (du côté donc de l’idéal), et fera son choix d’amour et de sexualité.
« Comment devenir un adulte, un homme, une femme ? », Quelle place je vais prendre dans la société ? sont les questions très sérieuses que se posent l’adolescent, et ces questions sont angoissantes car le monde paraît complexe et incertain.
Ce sont ces changements physiques et psychiques propres à l’adolescence, et les questionnements existentiels que nous retrouvons systématiquement dans les analyses sous des formes diverses et avec plus ou moins d’intensité, de charge d’angoisse, de sentiment de danger parfois imminent (poussant à des agirs spectaculaires), et d’inquiétante étrangeté face à un corps « assiégé » par un pulsionnel à la fois intime et étranger qui désormais envahit l’être.
Cet éveil pubertaire qui pousse l’adolescent à prendre des distances avec les figures parentales, constitue une véritable mise à l’épreuve des bases identificatoires du sujet, fragilisant ses assises narcissiques.
Dans ses écrits, Freud repère différentes formes d’identifications ; elles peuvent se superposer, se compléter ou s’avérer antagonistes ; certaines sont abandonnées ou rejetées par le sujet[2], d’autres adoptées, investies ou désinvesties, durant toute la vie psychique, dans un double mouvement conscient et inconscient, et un va-et-vient constant entre le dedans et le dehors (identifications aux paires, aux « petits autres », à l’étranger, aux adultes tutélaires, aux idéologies, etc.).
La théorie psychanalytique confère à l’identification une place centrale dans la constitution du sujet. Elle est «la première manifestation d’un attachement affectif à une autre personne » (S. Freud, « Psychologie des foules et analyse du moi »).
Cette succession des processus de dés-identifications/ré-identifications permet au sujet de « décider » ce qui le représente ou pas, ce qui ne doit pas changer et ce qui peut être modifiable en lui. Permanence et changement, deuil des identifications anciennes et intégration des nouvelles, l’ensemble de ce processus constitue ce que l’on peut appeler une quête identitaire, qui apparaît comme un mouvement dynamique, mais périlleux. Si périlleux que le sujet, notamment à l’adolescence, peut être amené à fixer un certain nombre de traits identificatoires impossible à remettre en cause, pour maintenir une unité du moi suffisamment stable et à en rejeter d’autres vécus comme incompatibles.[3] Cette rigidité du Moi exacerbe le « narcissisme des petites différences » jusqu’à pouvoir provoquer la rupture avec l’image de l’autre, et une désidentification radicale (il n’existe plus d’identification possible à l’autre en tant qu’image de soi-même). Du point de vue métapsychologique, la cruauté est rendue possible car la reconnaissance intersubjective est rompue : l’autre que j’égorge ou que je tue, n’est plus moi. En d’autres termes, le rapport à sa propre image spéculaire n’est plus soutenu par et dans l’image de l’autre, (si l’autre n’est plus moi, alors moi aussi je ne suis donc plus moi-même), pour aboutir à une désubjectivation radicale (sortie de soi).
Le narcissisme se réduit à un identitaire imaginaire surmoïque qui envahit et remplace la vie psychique, comme un dernier rempart avant la décompensation. C’est cette dynamique qui semble à l’œuvre chez les adolescents attirés par les fascismes et fondamentalisme religieux.
Investir le dehors (par opposition au dedans, c’est à dire la famille), le groupe, le sport, les aires culturelles, sont autant d’objets de sublimation qui permettent à l’adolescent, de se construire en tant que sujet social, d’exercer sa puissance créatrice sur l’environnement, de développer son estime de soi, et de mettre à distance l’enfance et les parents, pour son devenir adulte.
Le dehors, l’environnement extérieur dans lequel il évolue devient vital, car il est un agent de cicatrisation des blessures infantiles : tout ce que l’enfant a subi passivement parce qu’il était trop petit, à l’adolescence il va pouvoir expérimenter sa toute nouvelle puissance, maîtriser ce qui autrefois lui échappait. L’immaîtrisable en soi (montée des pulsions) se transforme en contrôle, en agir sur l’environnement (avec sentiment intérieur de puissance, d’estime de soi).
Mais si l’adolescent a le sentiment que l’environnement lui échappe, le rejette, qu’il n’offre rien, qu’il ne peut rien contrôler que tout est verrouillé par le politique et la répression totalitaire, qu’il y a nulle place symbolique pour la jeunesse, il nait alors un sentiment d’impuissant et l’adolescent peut devenir fou ; alors le besoin d’emprise sur l’environnement qui parait comme maltraitant peut prendre une coloration sadique.
Rappelons ce que disait Freud à propos du travail psychique à l’adolescence : « Le choix d’objets s’accomplit tout d’abord dans la représentation, et la vie sexuelle de l’adolescence n’a guère d’autres latitudes que de se répandre en fantasmes. (…) En même temps que ses fantasmes manifestement incestueux son surmontés et rejetés, s’accomplit une des réalisations psychiques les plus importants mais aussi les plus douloureuses de la période pubertaire : l’affranchissement de l’autorité parentale, grâce auquel seulement est créée l’opposition entre la nouvelle et l’ancienne génération si importante pour le progrès culturel. »
Ce qui nous porte à nous interroger sur le statut de l’adolescent dans nos sociétés dites arabo-musulmanes, et les spécificités de la dynamique qui lient l’adolescent à sa famille, à sa société, à la découverte de l’autre sexe.
Cependant, cette traversée adolescente dans la plupart des cas, ne demande de l’adulte tutélaire, qu’à être patient et de survivre aux attaques, à l’agressivité, et aux expériences parfois limites… Elle peut aussi nécessiter, l’intervention d’un psychanalyste ou d’un passage en institution, un espace transitionnel d’exploration des potentialités d’un soi, mais cette fois dans un espace à la fois contenant par ses limites symboliques, et qui permet la liberté de « tout penser » par sa dimension non surmoique.
Il s’agira alors pour l’analyste de maintenir avec l’adolescent, une « distance suffisamment bonne ».
Cette quête me paraît se faire toujours pour l’adolescent, dans une exigence de vérité sans concession vis-à-vis de lui-même, son être et ses désirs. Mais aussi sans concession vis-à-vis de l’analyste. L’adolescence ne connait pas le compromis.
« C’est à l’adolescence que s’exacerbent les obstacles internes et externes à l’appropriation par le sujet de ses pensées et désirs propres, de son corps, de son identité propre. D’où le recours aussi bien à la régression narcissique qu’à l’externalisation forcenée, au clivage, aux identifications empruntées, à la recherche éperdue d’une authenticité introuvable. »
C’est donc un enjeu crucial et éminemment sérieux qui se joue pour le patient, enjeu qui se présente sous la forme d’un « qui suis-je ? » et qu’il me semble fondamental d’éprouver en tant que psy.
Il s’agit pour le thérapeute d’une sorte de conscience profonde d’avoir en face de soi non un « ado qui fait sa crise », mais un sujet dans la dignité de son être, engagé « malgré lui », seul, dans une voie qu’il vit comme périlleuse, incertaine et non maitrisée, pour rejoindre cette « authenticité introuvable », son devenir adulte. Accueillir un sujet sous le signe de la rencontre et de la considération, non pas comme « patient », ce qui d’emblée l’objectalise, ni en se posant la question du diagnostic de structure, encore moins, en se posant la question divan ou pas…
Enfin, ce à quoi nous devons être attentif lorsqu’on reçoit un adolescent, c’est à sa demande et à ses modalités. Dans certains cas, il va plus s’agir de l’enfant dans l’adolescent, et d’autres fois, il s’agira de l’adulte en devenir. Je pense par exemple aux ados qui flanchent l’année du bac qu’ils perçoivent comme une échéance angoissante à plus d’un titre (demande récurrente du brillant élève qui ne fait plus rien). Alors il nous faut penser : est-ce que cet ado vient pour élaborer son devenir adulte inquiétant pour lui, ou parce qu’il « doit » revenir à une problématique plus fondamentale et qu’il ne peut avancer plus sans l’avoir résolu ? Ce sont 2 questions relative au sujet, différentes : l’une se pose en terme de « que vais-je devenir ? », l’autre serait de l’ordre d’un « qui suis-je ? ».
Pour les 1ers il s’agit de subjectiver l’avenir – ce qui n’empêche pas un aller-retour de l’infantile au devenir adulte et vice-versa-, en les allégeant du poids du passé, de l’ancien, de ce dont ils ne peuvent se débarrasser seuls (souvent par culpabilité de lâcher leurs parents, de ne plus être l’objet de jouissance de l’Autre).
Pour les seconds, il s’agit :
- Soit de subjectiver le passé en s’appropriant le sens et élaborer les non-sens, les trous de compréhension, de ce dont on est le produit.
C’est le cas de Richard et la question de la mort, transmission trans-générationnelle du trauma, de manière silencieuse, opaque, une sorte d’enclave psychique sans mot donc non secondarisable, métaphorisable, et non subjectivable.
Ou le cas de Victor dont la guérison a pu se produire lorsqu’on a pu reconnaître le désir parental comme non désir de l’avoir.
- Cela peut être un passé à construire, à expérimenter dans le transfert de ce qui n’a pas eu lieu dans l’infantile : c’est le cas de Eve dont l’analyse s’est articulée autour du besoin de construire, avec l’analyste, dans le transfert, -et non de reconstruire- une continuité d’existence, un besoin primaire « d’être » pour reprendre la formule de Winnicott (accompagnée par la présence sereine et la constance de l’analyste).
Nous avons parcouru au pas de course quelques-unes des nombreuses problématiques qui se présentent à l’adolescence et au clinicien, pour introduire à cette journée.
[2] Rappelons, d’abord, que le sujet freudien est le sujet de l’inconscient, des processus inconscients et de son pendant le refoulement.
[3] C’est par exemple le cas de l’identité sexuelle, issue des identifications œdipiennes, en lien avec la bisexualité psychique, et la confirmation (ou le conflit) narcissique spéculaire.


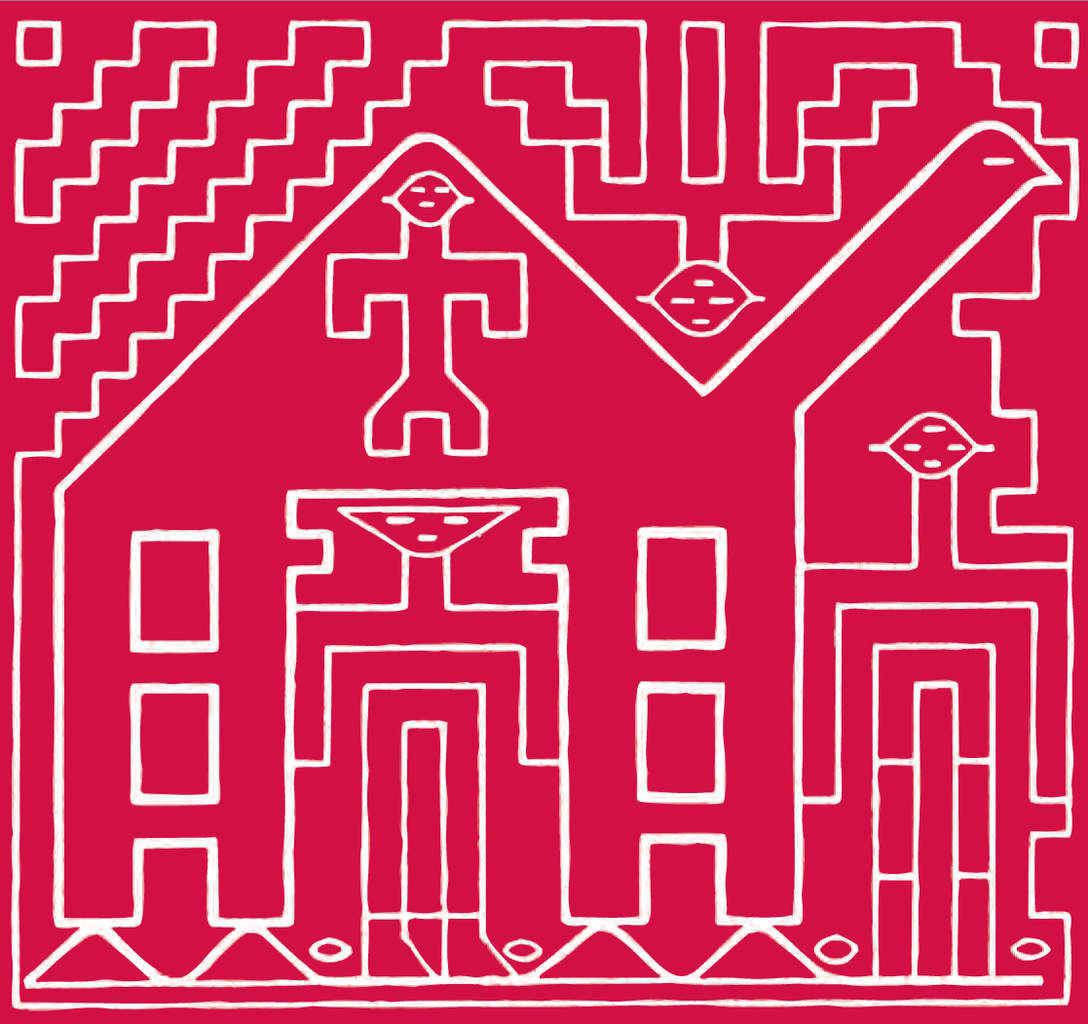
Laisser un commentaire