Image, Cinéma et Talons aiguilles
Aicha Ben Miled, Journée d’étude « Images et imaginaire » (AFPEC, 02/12/2017)
Il y a quelque temps, je suis allée au cinéma pour voir Talons aiguilles de Pedro Almodovar. Dans la salle, j’ai trouvé un public quelque peu excité, deux femmes assises à côté de moi n’ont pas cessé de rire d’un rire nerveux, très agaçant. Moi, j’étais là, assise au milieu de la salle plongée dans l’obscurité, littéralement captivée. Je découvrais cet univers étrange et nouveau pour moi : L’univers d’Almodovar. Quand le film était fini, je me suis retrouvée un peu comme hébétée, incapable de penser. J’étais alors curieuse d’entendre la réaction du public au cours du débat qui allait suivre la projection.
Un spectateur a fait remarquer qu’il n’avait pas ressenti d’émotion particulière vis à vis des personnages, difficile non plus de porter un jugement sur eux. Ce qu’il a dit a fait écho à quelque chose en moi. J’avais moi aussi l’impression de n’avoir rien ressenti. Car plus que des personnages, ce que j’ai vu c’était des images.
Et en effet, on a l’impression que la narration et l’intrigue sont mises en arrière-plan de l’environnement esthétique dans lequel évoluent les acteurs : Le réalisateur a l’air de contrôler tous les paramètres visuels du film. Les couleurs vives, dont le rouge (pour l’adulte Becky) et le rose (pour l’enfant Rebecca), envahissent l’écran, jusque dans les scènes d’extérieur où on voit les murs colorés de la ville. On dirait qu’Almodovar cherche à reconstituer un monde idéal inspiré des magazines pour femmes des années 80.
Je continuais à penser au film les jours qui ont suivi la projection. Mais quand, avec le recul, les choses ont commencé à prendre leur place, j’ai cherché à y mettre du sens. Est-ce c’est vrai qu’on ne ressent rien ? Je me suis posé la question. Dans l’après coup, j’arrivais un peu plus à mettre des mots sur mon émotion et c’est là que je me suis rendue compte que ce que j’ai ressenti, c’était bel et bien de l’angoisse. L’angoisse d’être figée, capturée ou engloutie. J’avais ressenti comme une sorte d’émoi face à des situations qui vont jusqu’à la limite du supportable. Et c’est ça le cinéma d’Almodovar. Un cinéma qui bouscule les préjugés en peignant une sexualité tout azumut. Un cinéma qui secoue le spectateur par où ça réagit, c’est-à-dire par le sexuel.
C’est donc à travers ce que m’a fait ressentir ce film que je vous parlerai aujourd’hui de l’image. Je vais essayer de partager avec vous mes impressions et mon analyse de ce très beau film et qui s’appelle Talons aiguilles (Tacones lejanos, en espagnol).
Comme le veut la tradition, pour préparer ce texte, j’ai donc commencé par lire les critiques qui sont parues à propos du film. Voici un extrait : « Almodovar a complétement raté le coche de l’empathie : Talons aiguilles n’est qu’un assemblage de personnages et d’éléments scénaristiques plus ou moins élégants, mais ne parvient pas à former un tout cohérent » (critique de Georges le chameau publiée dans le blog du cinéma du 16 août 2016).
Je suis d’accord, c’est bien ce qui apparaît de prime abord, mais est ce qu’on doit s’arrêter là ? C’est vrai que les personnages ressemblent un peu à des coquilles vides, mais n’est-ce pas aussi vrai qu’Almodovar explore avec finesse leurs obsessions intimes. J’ai l’intuition que oui. Les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent être ! a t-il l’air de nous dire.
Mais reprenons la critique. Ce film ne forme donc pas « Un tout cohérent », il n’y a pas d’empathie possible avec les personnages. C’est superficiel. Mais c’est justement de ça dont il s’agit ! Pour moi, Talons Aiguilles est un bel exemple baroque et caricaturé d’une parfaite aliénation de soi, d’un sentiment diffus d’exister dans des corps non différenciés : Les corps se dédoublent, les formes se transforment. Les situations sont indistinctes, tout est confondu. La frontière entre les sexes, les genres, les identités est complètement estompée. L’homme est dans la femme, la femme est dans l’homme, la mère est dans la fille, la fille est dans sa mère, la vie est dans la mort etc. D’ailleurs, on le voit bien dans le film, lorsque le mari de Rebecca, demande à Létal, personnage transgenre, s’il est masculin ou féminin, celui-ci lui répond « ça dépend, pour toi je suis un homme ».
Le premier plan du film nous montre Rebecca ou plutôt son reflet dans un miroir : elle porte un tailleur Chanel, coupe au carré et lunettes de soleil ; un style dans lequel on la sent mal à l’aise. Cette scène sonne comme un avertissement : « Ne pas se fier aux apparences » car dès la scène suivante on la voit qui se remémore un souvenir d’enfance où elle s’est sentie humiliée et écrasée par sa mère. Puis de nouveau, gros plan sur la Rebecca d’aujourd’hui. Le film commence alors qu’elle vient chercher sa mère à l’aéroport, Becky, ancienne célébrité des années soixante qui rentre après des années d’absence à Madrid. Becky est une image publique. On voit ses affiches partout dans les rues de Madrid.
Cette introduction en faux-semblants est caractéristique du cinéma d’Almodovar. Les personnages sont définis par leur apparences (celles qu’ils ont d’eux-mêmes et celle qu’ils donnent à voir aux autres), ils sont filmés dans des situations plutôt absurdes, sensuelles et sensibles. Almodovar s’amuse à nous faire croire que c’est ça… et puis finalement, non, ce n’est pas ça.
Dans le déroulement de l’histoire, on comprend vite que Rebecca est complètement obnibulée par l’image de sa mère. Elle cherche à lui plaire, tout en étant totalement confondue avec elle. Désespérément en manque d’amour maternel, elle épouse l’ancien amant de sa mère et se lie d’amitié avec Létal, un travesti qui a l’habitude d’incarner Becky dans les cabarets. Tout cela à lair bien gentil, jusqu’à ce moment où ce dernier l’entraîne dans une partie de “jambes en l’air” au sens propre comme au sens figuré. Dans un enchainement de scènes très rapides, on la voit alors suspendue par les bras à un tuyau pendant que le travesti, pas même démaquillé la pénètre. À peine cinq minutes plus tôt, celui-ci (ou celle-ci) faisait son numéro de cabaret en talons aiguilles et robe moulante. On la voit donc faire l’amour avec un homme-femme, véritable image incarnée de sa mère, comme dans une sorte de transition pour elle qui la mène vers le plaisir.
Pendant ce temps, la dite mère couche avec le mari de sa fille (qui n’est autre que son ancien amant), et quand celle-ci le lui reproche, elle lui répond : « Mais qu’est-ce que tu veux ma fille, moi je suis comme ça, je n’ai jamais su dire non aux hommes » ; la dite fille finit par tuer son mari et explique lors de son interrogatoire de police : « je ne sais pas pourquoi je l’ai tué, j’ai pris le révolver pour me tuer et puis finalement, c’est lui que j’ai tué ». Le tout est dit par des personnages qui ne semble obéir qu’au principe de plaisir avec cette tonalité accélérée et sensuelle, caractéristique de la langue espagnole.
Pour couronner le tout, Almodovar fait du personnage du juge chargé d’enquêter sur le meurtre de Manuel, une seule et même personne avec Létal, le travesti. Le juge, celui qui est garant de la Loi, celui dont le rôle est de mettre à jour la vérité est un travseti lui-même confondu avec l’image de Becky (qu’il imite), et qui finit par se corrompre en tombant amoureux de Rebecca en consentant à poser le voile sur sa culpabilité.
Mais cela ne fait rien, car le film d’Almodovar se nourrit d’une latinité où les pires excès de la passion peuvent être pardonnés. Almodovar dépeint avec beaucoup d’indulgeance et de sincérité la nature changeante de l’âme humaine. Quels que soient les crimes perpétrés, les douleurs infligées, ses personnages ont toujours droit à une seconde chance. Ils peuvent changer ; alors du juge et du jugement, on n’en a que faire.
Oui, mais Almodovar va loin. Et moi, je me retrouve entrainée dans un imaginaire fantasmagorique où tout est confondu.
Mais comme je le disais au début, j’ai l’intuition qu’il doit y avoir autre chose. Quelque chose à décrypter dans toute cette folie. Je reprends donc mes esprits…Je cherche un fil conducteur et je finis par entrevoir une issue, une ouverture, un mouvement possible vers le désir.
Car, aussi bizarre, aussi étrange que soit une œuvre, il faut qu’il y ait une identification possible, il faut quelque part qu’il y ait un caractère universel (implicite); autrement, l’œuvre ne peut être reconnue. Malgré sa singularité, elle doit nous permettre de nous identifier à quelque chose qui serait en nous, même si on l’ignore. Et pour moi, c’est ça qui fait la différence entre une œuvre réussie et un raté. C’est à dire, quand l’artiste est capable de bouger les choses et pour lui (selon sa vision singulière du monde) ; et pour les autres (grâce à une identification possible à quelque chose de l’ordre du semblable). Toutefois, notez bien que c’est inconscient ! Quand vous dites « ça me plait », « ça me parle », vous ne pouvez pas dans un premier temps dire pourquoi.
Le film d’Almodovar n’est donc qu’un instrument optique qui nous permet de sentir ce qui se trouve en nous-même. C’est cette issue, cette mise en mouvement, qui va convoquer en chacun de nous la possibilité de l’identifier par rapport à notre propre manque. Et c’est pour ça que l’univers d’Almodovar (bien qu’étrange et dérangeant) est accessible et reconnu par le public, il n’est pas replié sur lui-même puisqu’il nous permet de faire un retour en profondeur sur ce qui gît inconnu de nous, c’est à dire le désir.
Dans le film, Cette issue, ce que j’ai appelé « mouvement vers le désir » se conçoit grâce à deux possibilités :
- Premièrement, le Langage au sens large. Alors que Talons aiguilles joue sur les apparences, c’est par le langage et la narration que l’on sort de l’aliénation et de la capture narcissique.
Le langage et la communication sont là en tant que médiation: je pense à la confession de Rebecca en direct à la télévision, à Becky déclarant son amour à sa fille en chanson diffusée à la radio, (la très belle chanson de LUZ casal “Pensa in me quando souffras”): chanson, à travers laquelle elle s’adresse indirectement à sa fille et lui dit qu’elle peut accueillir sa souffrance. Car c’est bien par la médiation de l’autre que le « JE » s’objective. André Green parle de « fonction réflexive de l’objet » : il s’agit d’un cricuit qui ne porte pas sur les propriétés de l’objet mais sur la réponse de celui-ci « l’accusé récéption de la motion pulsionnelle du sujet ». Il permet l’avènement d’un sens donné, c’est à dire « l’interprétation pour un autre par un même » : Comme si l’Autre disait : Je humain comme toi, ce que tu dis, ce que tu vis, fait écho à quelque chose de semblable en moi. C’est là la seule condition qui peut donner lieu à une expérience de satisfaction dans un rapport spéculaire à l’objet. C’est la fonction réfélxive intrapsychique : un sujet signifie pour un autre ses états internes, c’est à dire qu’il leur donne du sens. Les nommes pour lui. Et n’est-ce pas de ça dont il s’agit en cure analytique ?
Ensuite, dans talons aiguilles, la narration qui semble s’être inscrite dans la discontinuité, qui semble décousue, s’inscrit quand même dans un fil conducteur et un fil séparateur (si je peux le dire comme ça): le fil de l’amour d’une mère envers sa fille et de l’amour d’un homme pour une femme.
Ce fil conducteur, on le retrouve dans l’histoire des talons aiguilles. Mais avant ça, je dois vous préciser que la traduction correcte du titre en français, c’est : « talons lointains ». Cette histoire est relatée par Becky qu’on voit confier à sa dame de compagnie à son retour à Madrid : « Je veux m’installer dans le même sous-sol où, quand j’étais petite, j’attendais que ma mère rentre le soir et je regardais les chaussures à talons des femmes de la rue, passer et repasser devant le soupirail.» Cette histoire, c’est une histoire à laquelle on peut s’identifier, ça nous parle. C’est l’histoire de quelqu’un qui souffre. Almodovar donne une dimension humaine à son personnage et explique en quelque sorte que derrière l’image que le sujet Becky donne à voir, il y a une personne.
Cette image que le sujet donne à voir, l’image qu’il a de lui-même, c’est l’image dans laquelle il est aliéné dira Lacan car elle relève du registre imaginaire. Et en effet ce qui se passe dans la capture narcissique c’est que quand le sujet-bébé rencontre son image dans le miroir il jubile de se voir unifié (il faut savoir qu’auparavant il se vivait morcelé !). Il se prend pour l’image et dit “l’image c’est moi”, mais il s’agit là d’une image idéale de lui-même qu’il ne pourra jamais rejoindre. Elle est extérieure à lui. Elle ne correspond pas à son contenu. C’est à dire que l’image dans le miroir anticipe une unité corporelle qui ne correspond pas à une unité psychique et marque un décalage entre ce que le sujet voit et ce qu’il est vraiment en tant que sujet.
Par l’histoire des talons aiguilles, Almodovar nous fait accéder à ce qu’il y a derrière l’image (au contenu) chez cette femme-icône à travers sa souffrance. Elle manque de quelque chose, il y a donc un trou, une béance. Elle devient mère si je puis dire en se reconnaissant d’abord comme sujet et peut enfin réceptionner la souffrance de sa fille, en séparant leurs deux histoires.
Ce qui m’amène au deuxième point et qui est la rencontre érotique.
- En effet, dans le film, c’est cette rencontre (avec le juge/travesti) qui met fin à la jouissance de la fille, c’est à dire qu’elle met fin à la répétition d’une recherche de l’objet perdu perpétuellement échouée. La fille peut enfin se séparer de sa mère pour se tourner vers un homme qui la désire.
En termes théoriques, cela voudrait dire que le narcissisme primaire à caractère fusionnel laisse place au narcissisme secondaire qui ne peut se construire que sur fond de séparation et permet l’accès au registre symbolique : Le juge enlève son déguisement, arrête de se travestir en expliquant que ce n’était là qu’un rôle qu’il jouait pour piéger les criminels. Il devient un homme à part entière en donnant à ce déguisement une signification. C’était pour faire semblant ; ce n’était qu’une image.
Car ce n’est pas la même chose que de se déguiser en femme, vouloir « paraître femme » que de se sentir femme. Ressembler et se sentir, ce n’est pas la même chose. Et c’est ce que dit Lacan quand il parle du stade du miroir. Pour comprendre le stade du miroir, je vous conseille vivement de vous intéresser aux travestis !
Voilà donc pour finir, comment Almodovar nous sort de l’aliénation après nous avoir « capturé » : C’est à dire, à travers le plaisir suscité par la rencontre érotique, plaisir qui peut seul mettre des limites à la démesure de la jouissance et délimiter les frontière entre le Moi et l’Autre. Rebecca peut enfin se séparer de sa mère et sortir de l’aliénation. Et à partir de là, on peut enfin dire que d’images, ils sont devenus désormais des personnages !
Bibliographie :
Boutroy, P. (1992). « Pedro Almodovar : une esthétique du travesti », Séquences 159-160 (1992) 42-45.
Dacosta, M. (2002). « Almodovar et l’art de narrer le même » le courrier de l’APM n18. Mai 2002.
Freud, S. (1914). Pour introduire le narcissisme. In, La vie sexuelle, Paris PUF (1969).
Green, A. (1983). Narcissisme de vie, narcissisme de mort, Paris. Editions de Minuit.
Hernandez Marzel, B. (2013). « Pedro Almodovar ou la maternité performée » in Transtextes, Transcultures 8 /2013.
Lacan, J. (1949). Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience analytique. In, Ecrits I, Paris, le Seuil.


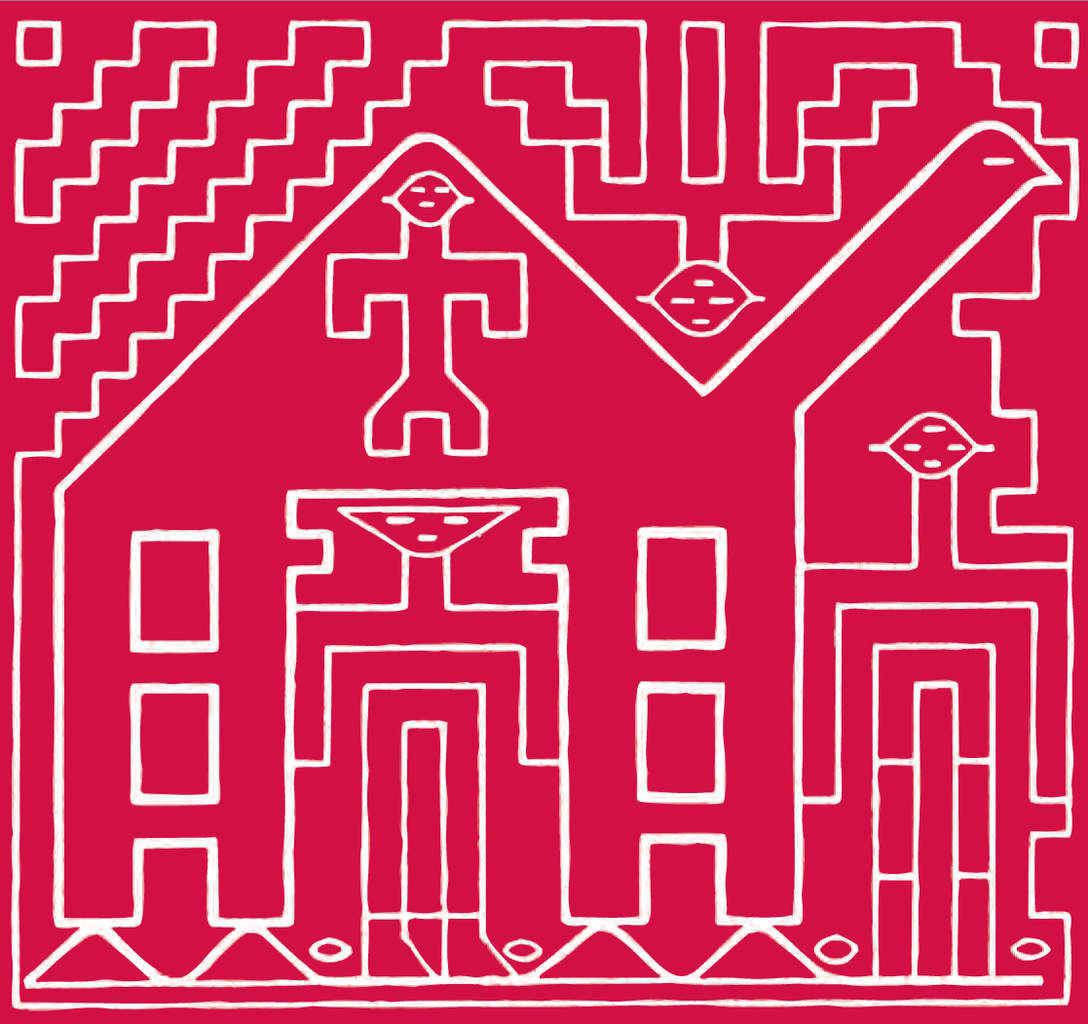
Laisser un commentaire