« Mais le Seigneur tout-puissant l’a châtié ;
il l’a livré aux mains d’une femme. »
(Livre de Judith, XVI, 7)
« L’homme désire et la femme est désirée,
c’est là le seul avantage de la femme…
mais Ô combien décisif »
(Sacher-Masoch, La Vénus à la fourrure)
1. L’énigme du féminin
Il se trouve que s’interroger sur la féminité est avant tout affaire d’homme. Ceux-ci tentent de tout temps de percer le mystère féminin, pensant à tord, à l’instar de Freud, que la question ne se pose pas pour la femme, puisqu’elle en est elle-même l’énigme. Mais n’est ce pas là un désir d’homme que de maintenir ce mystère ? N’est ce pas encore lui qui la veut parée d’emblèmes magiques et de filtres d’amour ? Un homme qui vient lui dire que la vérité sur la féminité ne lui est acceptable que si elle reste mystère ? Lacan ira jusqu’à dire que : « La femme n’existe pas ». Une énonciation qui n’est pas non plus dénuée de mystère. Mais au fond, il s’agit pour Lacan de nous amener à percevoir ce qui ne relève pas « du semblant » ou « du rôle » chez la femme, puisqu’il l’appréhende à partir de ce qu’il appelle « le réel ». La femme n’existe pas, mais les femmes existent. Cela revient à dire qu’il n’y a pas de signifiant propre pour la désigner. Ce qu’il appellera « le signifiant le plus caché », se constitue donc en référence au signifiant phallus et c’est ce qui en fait une énigme, mais pas que…
Quelque chose d’autre vient entretenir le mystère dans le dialogue sur le désir qui s’instaure entre hommes et femmes, quelque chose de l’ordre du « je ne veux pas trop en savoir » qui n’est certes pas l’apanage du sujet pervers. Allant dans le même sens, les femmes, parce qu’elles s’interrogent elles-mêmes sur leur féminité, succombent avec délice aux propos flatteurs des hommes, les élévant au statut de reines, voire de déesses. Pourquoi ? Il me semble que Freud répond en partie à cette question dans son texte « Pour Introduire le narcissisme ». Et l’une des raisons qu’il évoque serait la différences entre hommes et femmes au niveau du choix d’objet, plutôt narcissique pour les femmes et anaclitique pour les hommes. Le besoin des femmes serait, d’après lui, non pas d’aimer mais plutôt d’être aimées. L’aspiration à la beauté pour les femmes serait donc une sorte de « dédomagement de la restriction d’ordre social ». Dans le même sens, nombreuses sont les références aux femmes intriguantes qui ont marqué l’histoire dans « La Vénus à la fourrure » : Cela passe de l’Odyssée avec Circé à la despote Catherine II de Russie, en passant par les héroines mythologiques telles que la belle Hélène, Aphrodite et Psychée ; Enfin des personnages bibliques avec Dalila et Judith, pour finir par remonter jusqu’à l’égypte ancienne et sa célèbre Isis. Dans ces voluptueuses descriptions, les femmes y apparaissent tantôt belles et protectrices, tantôt tyraniques et cruelles. Mais derrière toutes ces comparaisons audacieuses, se cache une femme, une femme de pierre, ou plutôt une femme de marbre. Une femme qui ne manque de rien, à la jouissance insondable, dont elle ne peut rien en dire ou quasiment. Figée et piégée dans le royaume imaginaire et fantasmatique des hommes, elle se demande, solitaire, si elle peut être aimée pour ce qu’elle n’est pas, en dépit de ce qu’elle n’a pas ? Nous allons donc parler de ce que l’auteur maintient délibérément ou pas dans le mystère, de « cette impossible réalité qui fait lieu du manque », de ce qui est l’objet véritable qui le fascine et où se perd son désir. En dépit de ce que l’auteur nous cache et tente de se cacher à lui-même, nous nous interrogerons sur ce que veut la femme ? Sur ce qu’elle sait de sa féminité ? Et de ce que l’on vient lui en dire ?
2. Un corps divinisé: l’attrait narcissique
Revenons un instant à Freud. Toujours dans « Pour introduire le narcissisme », et toujours en comparaison avec les hommes, il parle d’une augmentation du narcissisme originel chez les femmes, avec l’évolution de la puberté, et explique que c’est ce qui serait défavorable à la formation d’un objet d’amour en bonne et due forme. Selon lui, les femmes n’aiment qu’elles-mêmes avec une intensité analogue à celle dont l’homme les aime. Leur besoin n’est donc pas d’aimer mais d’être aimées. Pour Freud, ces femmes « narcissiques », fascinent les hommes, non seulement pour leur beauté mais aussi parce que, je cite : « le narcissisme d’une personne exerce un grand attrait sur ceux qui se sont livrés à la pleine mesure de leur propre narcissisme et se trouvent en phase de conquête de l’amour d’objet ». Mais Freud ne s’arrête pas là, il continue en comparant la femme au chat qui attire tant les humains puisqu’il ne semblent pas se soucier des autres, du haut de son autosuffisance et son innaccessibilité. Il dit pour finir, en parlant des femmes :« il semble que nous les jalousions pour avoir maintenu un état psychique bienheureux, une position inattaquable de la libido». Ces propos ne sont pas sans me questionner sur la vision que Freud avait des femmes. Je me souviens alors de cette phrase de Lacan qui dit (non sans humour) du fondateur de la psychanalyse : « Heureusement Freud était névrosé, et comme il était à la fois intelligent et courageux, il a su se servir de sa propre angoisse devant son désir, laquelle était au principe de son attachement ridicule à cette impossible bonne femme, qui d’ailleurs l’a enterré, et qui s’appelait madame Freud ». (séminaire L’angoisse).
Loin de moi l’idée d’analyser Freud, mais je suis tentée de dire que lui non plus, n’a pas manqué d’être confronté à l’énigme du féminin…
3. Du corps divinisé au corps fétichisé
Dans un décor qui s’enracine dans une petite ville des Carpathes, Séverin rencontre Wanda : elle est jeune, belle, riche et veuve. Comparée à la déesse Vénus, elle est mise à une place d’être idéalisé, divinisé, et devient tout de suite l’objet de passion du héros de Sacher-Masoch à qui il fera dire : « Je voyais dans la sensualité un je ne sais quoi de sacré, voire même, la seule chose qui fût sacrée, et dans la femme et sa beauté, quelque chose de divin ». C’est en cela qu’il la désire. Pourtant ce corps divin, est pour lui incomplet, il lui manque certains attributs qui retiennent particulièrement notre attention dans la description qu’en fait Sacher-Masoch : La femme ne pourra être la déesse Vénus « qu’ensauvagée par une fourrure » avec un tempérament de bête sauvage. Elle est armée d’un fouet, qui semble être l’extention de la ligne des ses mains. Cette image de la femme est renchérie par les nombreuses références aux tableaux des grands maitres cités dans le roman, et particulièrement, le tableau de Titian « La Venus au mirroir », chef d’œuvre dans lequel le peintre pare également sa déesse d’une sombre fourrure. C’est beau et c’est poétique. Mais cette fourrure a une signification bien particulière pour le narrateur mais aussi pour l’auteur qui fait référence dans son livre à un souvenir d’enfance, où il fût battu par une tante vêtue d’une veste en fourrure. Il ne cessera de faire allusion à cette chaleur qui s’oppose à cet univers « froid et cruel » dont parle Deleuze à propos de Sacher-Masoch. Pour l’écrivain, « les fourrures exercent sur les personnalités nerveuses un effet stimulant. Celui-là repose sur les lois générales de la nature (…) Ainsi, les zones chaudes produisent les hommes les plus passionnés, les atmosphères brûlantes engendrent l’excitation ». cette atmosphère peinte n’est pas sans contraster avec le milieu puritain où baigne Sacher-Masoch, le christianisme du nord.
3. Le dialogue sur le désir
Dans les premiers temps de leur rencontre, s’instaure un dialogue sur le désir entre Séverin et Wanda, au cours duquel Severin lui expose sa vision de l’érotisme et de ce qu’il en est de son désir pour les femmes. Il ne demande encore rien à Wanda. Ce que l’homme veut croire, c’est que c’est lui qui a choisi. Ce qu’il revendique par là, c’est son statut de « désirant par droit divin ». Et même s’il veut être désiré comme tout un chacun, ce qu’il ne peut supporter c’est que sa suprématie phallique ne le dispense pas de cette sujétion du désir et d’être « désir de désir ». Voilà le voile par lequel il enveloppera son désir. Ce que la femme revendiquera en revanche c’est d’être choisie par ce même droit divin ; qu’elle soit désirée par la volonté d’un autre. C’est là la métamorphose qu’elle tente de réaliser au niveau du manque, mais cela suppose que le Désirant la valorise et lui montre qu’elle est unique. Ainsi, dans son article intitulé « La féminité et ses avatars », Piera Aulagnier explique: « Que la femme puisse s’affirmer qu’elle n’est manquante d’aucun désir et qu’elle se fait don au désir de l’homme et non appel, voilà sa façon à elle, de poser le voile sur son désir». Mais « Si l’homme lui dévoile qu’elle est non seulement désirable mais avant tout désirante de son désir et de ce fait, qu’elle peut en être manquante, c’est là qu’est pour elle le point névralgique ». Et ce n’est que dans l’étreinte amoureuse qu’elle pourra soutenir cette vérité, parce que l’homme aura réussi à lui prouver son amour pour elle. Comme toute femme, Wanda aspire à l’amour et « son cœur n’aspire qu’à captiver les hommes pour longtemps ». Elle en est là quand elle rencontre Séverin. Elle commence par le tourner en dérision et s’étonner d’être ainsi l’objet de sa passion dévorante, pour finir par en devenir elle-même dépendante de son désir. Elle cherche par là une sorte de valorisation narcissique, s’aimant elle-même selon l’intensité de l’amour que lui porte l’homme. Nous rejoingnons là ce que Freud disait de la femme narcissique. Mais dans le même temps, Wanda sait, elle sent, qu’elle n’est qu’un objet interchangeable, l’objet a (comme dirait Lacan). Cela sucite son angoisse qu’elle exprime en refusant à son partenaire toute possibilité de l’identifier à un objet du manque. Son pénis ne sera plus pour elle, ni pour lui, l’emblème du Désirant par excellence et ce sera lui, qui, à tout instant devra s’interroger sur ce qu’est, pour elle l’objet du désir. Severin cherchera constament à connaître son désir, mais qu’en est-il de son plaisir ? Voici une question qui reste en suspens. C’est que pour la femme, le désir ne donne pasnécessairement lieu au plaisir. C’est pourquoi, en clinique, nous serons toujours amenés à nous interroger sans cesse sur le rôle que joue le plaisir pour la femme dans cette mise en scène dont l’acte final du scénario serait le plaisir orgasmique. Un plaisir, qui, quand il fait défaut, laissera place à la douleur. Et c’est «cette contiguité douleur/plaisir qui permet de comprendre pourquoi la femme peut avoir tendance à érotiser la souffrance qu’elle cache le plus souvent à l’autre, pour se présenter comme source inépuisable de plaisir ». Une douleur réelle mais qu’elle cache car elle sait qu’elle pourra toujours cacher les défaillances.
4. Le désir chez la femme
L’amour servira toujours d’alibi pour la femme : « Je désire parce qu’on m’aime », telle est sa devise, comme si quelque chose s’oppose en elle à ce qu’elle soit uniquement objet de désir et non objet d’amour. De ce désir d’homme, elle pourra faire la source même de son investissement narcissique. Elle pourra alors accepter que c’est en tant que sujet du manque et non pas en tant qu’objet (position inacceptable pour elle, si ce n’est dans une perversion), qu’elle pourra trouver sa place de désirée.
« Dans le plaisir qu’elle permet à l’autre, et qui deviendra le sien, elle verra la preuve que le manque n’est pas équivalent de castration. A ce pénis qu’elle n’aura jamais, elle offre dans le plaisir qu’elle accepte, la réalisation de la métamorphose phallique », comme l’explique Piera Aulagnier. Pour comprendre comment cela s’origine pour elle, retournons une fois de plus à Freud. Dans son texte sur la sexualité féminine, il parle d’un changement de choix objectal qui doit avoir lieu pour la fille et évoque une sorte de dépit, de déception qui serait à l’origine de ce changement. Selon lui, à un moment précis, la petite fille, en se détournant de sa mère, la « privera du pouvoir narcissique qui était le sien pour le transférer sur l’homme ». Mais la petite fille peut être amenée à penser que la féminité de la mère est trompeuse car c’est ce qui vient tromper le père pour en capter son désir. C’est pourquoi, c’est l’homme qui lui parlera le mieux de sa féminité, c’est lui qui la fera femme en quelque sorte, en proclamant où se trouve l’objet de son désir à lui : comme par exemple dans telle manière de pencher son cou ou telle expression de son regard. Selon Piera Aulagnier, la féminité, c’est donc « le nom donné par le sujet du désir (donc l’homme) à l’objet, car il ne peut se nommer parce que manquant ». Le propre de la féminité, c’est donc qu’elle ne peut être reconnue que par un autre. C’est pourquoi tant de femme vous diront qu’elle ont été remises en question dans leur féminité par l’homme qu’elles aimaient. Ce est qui important ici à retenir, c’est que pour la femme, son statut de désirée, ne repose sur aucune réalité objective. En d’autres termes, de ce mouvement qui porte la petite fille de la mère vers le père, il faudrait que l’envie de ce qu’elle n’a pas (que ce soit le pénis ou la féminité), se substitue à la joie du don, un don de soi, qui ne peut se soutenir pour elle que de l’amour en échange. C’est à ce prix que plaisir et désir peuvent coincider pour elle. Et c’est dans ce sens que nous avons commencé par parler de l’amour comme alibi indispensable pour la réalisation de son désir. Voyons comment cela se passe pour Wanda : Elle s’intéresse à Séverin en ceci qu’elle trouve « qu’en lui sommeille une certaine pofondeur, un certain enthousiasme, et avant tout, dit-elle : « un sérieux qui me fait du bien ». Elle commence à l’aimer, elle est bonne envers lui. Mais bientôt il lui demande sa main. Elle le repousse, hésite car elle doute de la longévité de ses sentiments et veut le tester. Elle lui accorde un délai. Ce qu’elle aimerait, c’est, je la cite : « appartenir à un homme pour la vie, à condition qu’il soit un vrai homme et qui m’en impose (…) un homme qui me soumette avec toute la violence de son être ». Voici comment Wanda désire être aimée. Hélas pour elle, à ses paroles, Séverin se jette à ses pieds et veut lui appartenir sans réserve, la suppliant d’être insolente et despotique envers lui, de le fouetter et d’en faire son esclave. Elle est étonnée. Elle lui demande de se reprendre et lui explique que ce n’est là ni le moyen de la conquérir, ni de la garder. Séverin n’écoute pas ce qu’elle lui dit et se met à déployer ses fantasmes extravagants. Dans le même temps, il excite sa rivalité envers les autres femmes en lui citant rien de moins que Catherine II, Héléne, Aphrodite et Psychée, sans oublier Vénus… Notons au passage que c’est quelque part par le biais de la revendication jalouse avec les autres femmes que Severin provoque le désir de Wanda. Ainsi se présente le désir chez Wanda. Elle caresse le rêve de devenir, pour l’aimé, l’objet unique de sa passion, elle voit là, une sorte de réalisation idéale de cette visée qui est la sienne : être désirée. Cette place, ce rôle, la fascine et c’est là la voie par laquelle se perverti son désir en donnant lieu à une sorte de prolifération pathologique de sa démarche d’être de désir. Elle oscille dans un cycle d’identification entre deux tendances qui s’opposent: Tantôt, elle est cette femme que Séverin voudrait qu’elle soit dominatrice et sadique; et tantôt elle lui reproche de la pervertir, de l’exciter, faisant d’elle un pur objet. Ainsi lui dit-elle : « vous éveillez mon imagination et vous faites battre mon cœur, vous êtes homme à corrompre une femme au plus profond d’elle même ». En effet, Sacher-Masoch a merveilleusement su mettre en scène cette dualité propre au sado-masochisme. Il s’agit pourtant d’un simulacre, et c’est là qu’elle semble y voir l’essence même de son plaisir. Le plaisir de se plier totalement au désir de l’autre pour être l’unique objet de sa passion. Dans la Vénus à la fourrure, Wanda, femme cruelle et despotique, est rendue telle, en écho aux fantasme bien explicites de son amant. « Etre le marteau ou l’enclume », sera l’expression empruntée à Goethe par Sacher-Masoch pour métaphoriser la relation homme-femme en signifiant par là que la femme ne peut être que l’esclave ou le tyran de l’homme, jamais son égale.
5. La perversion chez la femme
On nous dit que la perversion n’existerait pas chez la femme, dans le même temps, le masochisme apparaît comme un trait spécifique de « l’Être femme », comme quelque chose qui la caractérise. Je me pose alors deux questions : Par quel voie la femme entre-elle dans la perversion ? Et comment corrobore-t-elle la perversion de l’homme qui est son amant ? Si la visée du pervers concerne le désaveu de la castration, la visée de la femme serait alors de se faire la preuve existente de la vérité de ce désaveu, « en venant prendre la place de cet objet a, assurant ainsi à son partenaire qu’il ne manque de rien si elle est là et de tout si elle disparaît » explique Aulagnier. C’est là, le fondement même de la position masochiste. Dans le jeu érotique, Wanda dira à Séverin, que si elle est allée si loin, c’était pour lui faire plaisir, pour que jamais il ne cesse de l’aimer. En somme, ce serait pour lui faire croire qu’elle peut répondre à tous ses désirs. Elle est donc prête à payer très cher le plaisir qu’elle donne, pourvu « qu’il fasse d’elle le seul étalonnage de l’objet du désir ». « La nature est tromperie, nous dira la femme perverse, la seule vérité est celle du plaisir et ce plaisir doit être trompeur » (car il nie le manque). A l’instar de Wanda, la femme perverse instaurera ce rapport particulier entre plaisir et désir, qu’elle présentera comme un sacrifice, comme « un holocauste », coiffée de cette « couronne flamboyante de martyr ». C’est à ce prix qu’elle paiera une blessure non cicatrisable de ce manque, de ce « pas-de-pénis » et qui fera métamorphoser le plaisir en souffrance, seule voie ouverte à la satisfaction du désir car elle n’aura pas pu surmonter l’envie et l’amertume envers celle qui a été le premier désirant et qu’elle accusera de tromperie, reprenant à son compte, dans une surenchère sans fin de souffrance, cette idée que le plaisir ne peut être que trompeur. Wanda ne cessera de réclamer un homme et non un esclave. Elle ne devient sadique qu’à force de ne plus pouvoir tenir le rôle que Séverin lui impose. Elle apparaît très lasse dans ce rôle de dominatrice, lasse de porter ces lourdes fourrures, lasse d’utiliser le fouet. Sartre ne s’est pas trompé quand il a dit de Sacher-Masoch qu’il utilisait le grand amour que les femmes éprouvaient pour lui pour se faire insulter, mépriser, c’est à dire pour « agir sur elles en tant qu’elles s’éprouvaient comme un objet pour lui » (Sartre, l’Etre et le Néant). Wonda se trouve prise au piège d’un fantasme au nom de ce « Savoir-du-Plaisir » dont elle veut être la détentrice ; elle ne cessera d’inventer des stratagèmes pour montrer à Séverin qu’elle sait, que elle seule peut lui donner du plaisir. Mais ce n’est pas sans dépit qu’elle lui dira dans sa lettre finale : « Je peux vous avouer encore une fois que je vous ai beaucoup aimé ; c’est vous-même, votre abandon abracadabrant et votre passion insensée qui a flétri mes sentiments ».
En conclusion
Dans la fiction de Sacher-Masoch, l’héroine finit par se lasser d’un jeu auquel elle ne semble adhérer qu’en surface ; c’est qu’elle n’est pas dupe : elle a très bien réalisé que le proposant c’était lui, Séverin. Il est celui qui lui inspire les idées, formule les fantasmes, dans un rapport exigé par lui-même. Elle va pourtant finir par prendre Séverin à son propre piège. Ainsi, à la fin du roman, le rival incarné par le grec, jouera le rôle qui lui a été prescri, puisque Séverin l’aura en quelque sorte choisi. Séverin incite Wanda et la dirige vers son rival : « un beau militaire fétichisé ». L’homme est décrit dans sa superbe. Il est splendide, c’est un mâle. Dans son ambiguité, Sacher-Masoch fera dire à son héros : « Je comprends maintenant l’érotisme qui émane de l’homme et j’admire Socrate qui reste vertueux en face d’un Alcibiade aussi séduisant ». Et nous ne sommes pas sans rappeler ici que le fétichisme se présente, somme toute, comme rempart contre l’homosexualité. Le roman de Sacher-Masoch tire sa richesse et sa force dans le fait qu’il soit inspiré de de sa vie : l’épisode de la tante Zénobie, le rival incarné par le grec et le voyage à Florence, sans compter les innombrables femmes qui ont incarné le rôle Wanda dans la vie de l’écrivain. Des femmes, à qui il donnera des noms d’emprunt comme à Angelika Aurora Rumelin qui deviendra Wanda Von Sacher-Masoch et sera pour un temps l’épouse de l’auteur, avant de le quitter pour un autre. Comme dans la vie de l’écrivain, Wanda finit par passer de la complicité à la trahison en rencontrant son homme fort, qui seul peut la rendre heureuse puisqu’elle a pu occuper une autre place, une place bien plus rassurante, une place qui lui garanti de pouvoir être aimée malgré son manque. Une place que Séverin lui refusait. Bien que l’auteur ait une vision des femmes triomphant sur les hommes, il s’agit là d’un triomphe qui les veut clouées sur place. Une place où elles ont été idéalisées et divinisées mais une place qu’elles auraient mieux fait de refuser, une place où elles font figure d’objets interchangeables, prises dans le prisme « d’un narcissisme à rebours » où elles se sentiront de plus en plus dévalorisées. A choisir entre humain et divin, je répondrai donc humain! Car bien qu’il soit tout à fait tentant de se voir idéalisée ; en acceptant cette place, la femme leurrera l’homme et se leurrera elle-même, que son désir est l’équivalent de son plaisir, qu’elle est un tout et qu’elle peut répondre à tous les désirs (à l’image d’un dieu). Mais cette place dois-je le rappeler, n’est pas tenable sur la durée. Si la femme occupe cette place idéalisée, elle ne pourra plus se constituer sujet de désir pour elle-même. Alors oui, elle est un « corps désiré », mais cela ne devrait pas exclure qu’elle puisse être pour elle-même un « corps désirant ».
Bibliographie :
Aulagnier, P. (1967). Le désir et la Perversion. Paris. Seuil.
Deleuze, G. (1967). Présentation de sacher-Masoch : le froid et le cruel. Paris. Broché
Freud, S. (1914). Pour introduire le narcissisme. Paris. Petite bibliothèque Payot. (2012)
Freud, S. (1931). Sexualité féminine. Paris. Broché (2014)
Sacher-Masoch, L. (2013). La Vénus à la fourrure. Paris. Pocket.


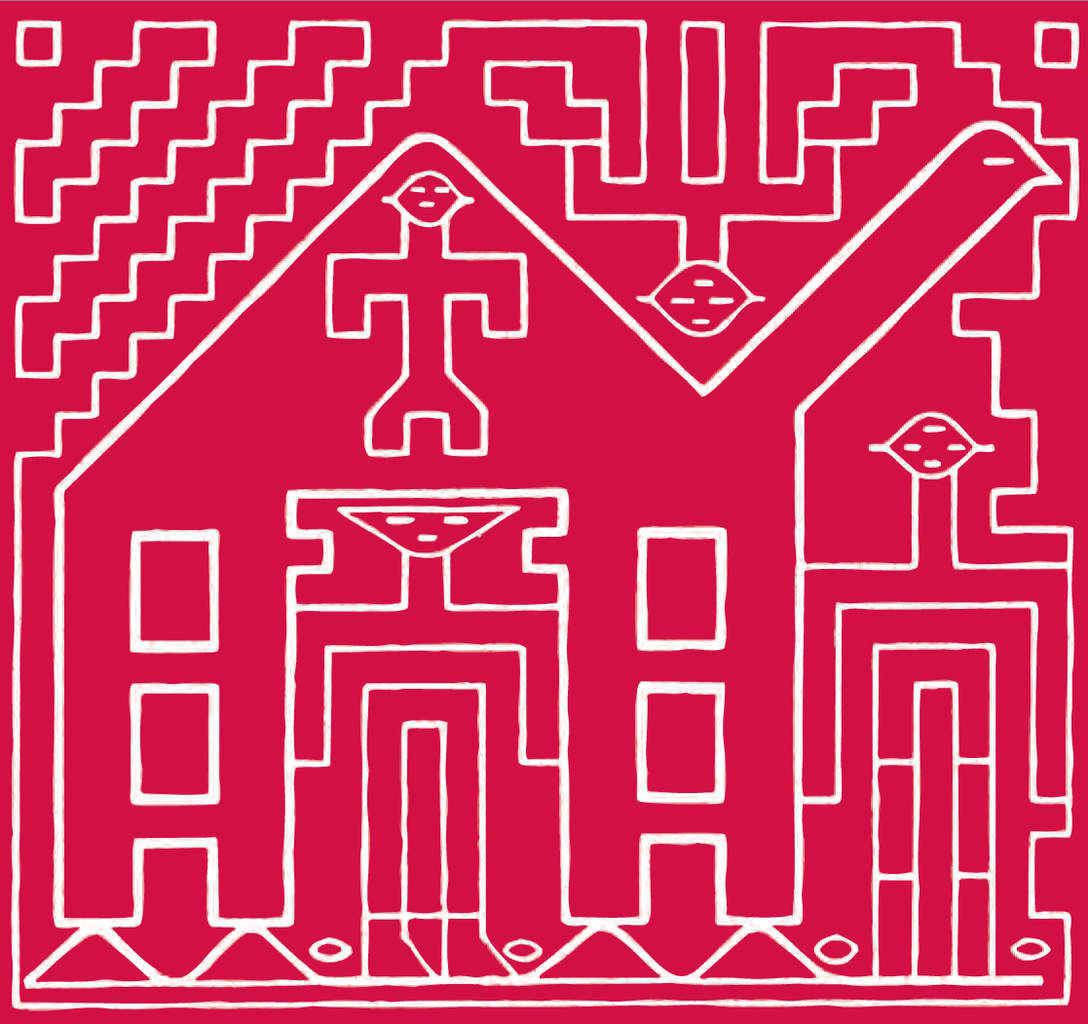
Laisser un commentaire