Le “ sujet ”
Ouvrir une discussion sur les conditions de possibilités d’une anthropologie clinique doit partir d’une distinction, rendue classique par les travaux issus de Lacan, entre l’individu, considéré dans sa singularité et son épaisseur identitaire –souvent composite- et le sujet. Ce dernier terme n’est pas superposable à l’individu biologique et au sujet de la connaissance ; soumis aux lois du langage et pris dans des opérations de discours propre à tel ou tel lien social le sujet se donne à la consistance par le symptôme.
Une telle tri-partition ne va pas de soi puisque du point de vue de l’épistémologie classique des sciences sociales l’individu constitue l’objet de la psychologie , voire de la psychanalyse, tandis que le social ou le collectif demeure l’objet des sciences sociales.
Que change donc cette introduction du terme de sujet pour qui tente de situer les opérations actuelles de production des identités et des montages des identités à l’altérité ?
Le lien et la colle sociale
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Le sujet qui nous importe est bien ce qui troue d’énigme un savoir portant sur les conduites et les discours, à la différence de ce qu’exigent et produisent les modalités conventionnelles des fabriques de profils adaptatifs à l’ordre et au désordre. Les cliniques de l’acte , et les dimensions de l’énonciation, sont, non seulement en contradiction, mais plus encore, en hétérogénéité avec la psychologie conventionnelle de l’acculturation.
Le sujet tel que nous le situons est traversé par la dimension inconsciente, elle même perméable au social, au lien social, c’est-à-dire au discours. En toute logique donc, la psychanalyse ne peut que porter interrogation sur la logique et la nature des “ Biens ” qui rendent consistants toute forme d’appareillage social. Nous pouvons noter qu’à côté d’une somme considérable de discours qui définissent le but du regroupement social en termes d’intérêts ou d’ethos (tel l’ethos du travail), la psychanalyse freudienne voit dans l’éros la nature propre de la colle sociale, telle que cet éros se figure dans les différents styles de l’amour d’un Père.
À partir de quoi, nous assistons au sein de la littérature psychanalytique à des façons assez contrastées de penser cet amour d’un Père et le prétendu “ déclin de la fonction paternelle ”, au risque parfois chez les tenants de cette dernière inquiétude de valoriser de nostalgiques regrets pour les patriarcats, alors même que c’est bien aussi et souvent au Nom de l’Amour pour le Père que des destructions fratricides se déchaînent. Cette nostalgie nous intéresse, pour ce qu’elle est, non l’acuité d’un point de vue, mais un symptôme pétri d’une confusion entre alliance et filiation, une façon à la fois de voir et de ne pas voir que la matrice œdipienne n’est sans doute pas si puissante que cela à formater les conflits et les souffrances psychiques actuelles.
Quoi qu’il en soit, c’est bien dans cette spéculation, somme toute exactement freudienne, sur le destins d’éros comme colle sociale que se joue le ressort des discussions cliniques et anthropologiques sur l’identité.
Sigmund Freud dans sa célèbre Massen Psychologie…, traite l’homme pris isolément en tant que partie constituante d’un amas humain qui s’organise en masse à un moment donné pour une fin déterminée. Le travail de l’inconscient interfère tout autant dans le discours et donc le lien social que dans le fonctionnement psychique au singulier. C’est là le point de départ de toute anthropologie culturelle référée à la psychanalyse.
Les remaniements de la métapsychologie freudienne sont corrélés aux différents moments de la théorie psychanalytique de la culture. L’entrée de la pulsion de mort dans le champ clinique élève le “malaise” au rang d’une catégorie de lecture du collectif. C’est aussi au plan du collectif que devient possible une lecture clinique des effets de Thanatos. Le champ socio-anthropologique devient, lors des années 20, un terrain d’application est un des lieux de « mise en réserve » des nouvelles théories des montages et des machines pulsionnelles. L’étude des structures anthropologiques débouchent sur la question du lien social et du politique.
La dimension actuelle d’une anthropologie clinique serait, à partir de cette intuition freudienne de situer le sort contemporain des médiations subjectives. Les médiations subjectives de la différence des sexes, donc des générations, ne sont pas finies (au sens d’une finitude, comme il fut parfois pensé si vite une “ fin ” de l’histoire), ni infinies (au sens où elle serait totalement immergée dans le style de chacun, bien qu’elles se retrouvent refoulées dans le domaine de la vie privée des sujets personnels. Des objets anthropologiques et instituants connaissent des mutations profondes. Mutations qu’attestent et dramatisent les martyrologies paritaires, victimaires, minoritaires etc. Se créent alors des sous-cultures minoritaires qui se situent hors-jeu de toute discussion sur leurs idéologies sous-jacentes par la mise en avant de droit spécifique, voire de manière spécifique de vivre, de mourir, de souffrir, d’aimer et de devenir fou. Dans un rabattement du semblable sur l’identique, ces micro-groupes, se situent dans des rempardements assez ahurissants qui provoquent une réelle inflexion du juridique. Tout style de vie, pourtant, n’as pas à être fondé en droit.
Nous sommes passé d’un monde régi par des institutions universalistes à un monde d’organisation globalisé et d’appareils de manière horizontale, pragmatique dépourvue d’amplitude questionnelle.
Dans ce sens, il est de plus en plus demandé au droit de légitimer des façons de vivre et de garantir aux pathos victimologique le soin de focaliser les identifications. La confusion entre droit et institution est grandissante . Transposition non critiquée d’une anthropologie populaire qui réduit la culture à de la psyché ou de la technique.
Les psychologues cliniciens ne sont pas assez attentifs à ces effets de confusion et ils cèdent parfois à des rêveries utopistes et a topiques concernant le rapport de chacun à la loi. En raison de deux défauts de pensée. D’une part en identifiant la coutume au droit, sans se rendre compte que, par exemple, chez des exilés qui mettent en alerte des dispositifs de droit commun au sein desquels nous travaillons, doit d’abord être considérée la signification personnelle, particulière, voire symptomatique ou encore psychopathologique du rapport de chacun a ce qu’il fait de ce qu’il croit être sa coutume. Je pense ici que l’enseignement, à mon avis sans réels disciples , de G. Devereux peut encore aujourd’hui aider le psychologue clinicien, et, tout particulièrement en ce qu’il énonce de la distinction incommensurable et non comblable entre “ motifs psychologiques ” et “ motifs sociologiques ” d’une conduite. Mais il faut rajouter aussi l’aspect commode expéditif et stigmatisant de certains de ces appels au “ culturel ” comme facteur uni-explicatif, au risque parfois de confondre toutes les scènes (anthropologique, pénale, éducative) avec une scène thérapeutique et un dispositif thérapeutique.
Les modes d’institution des subjectivités
Depuis Freud, l’anthropologie, qui était bien loin d’être une science constituée à l’époque de Totem et Tabou (1912-1913) a changé. Et, de même a évolué la psychologie dite culturelle.
Si la notion d' »identité culturelle » a pu occuper une position centrale dans l’analyse de l’organisation psychique, cette notion malaisée, encombrante et symptomatique est à situer maintenant dans des dynamiques de confrontation à autrui, dans ses montages logiques et non plus comme une substance d’être, en danger et à préserver de toute altérisation tenue pour un facteur de déstructuration pathogène. Les violents surgissements de luttes identitaires ramènent au premier plan d’une actualité souvent désespérante la nécessité de penser les dynamiques d’affect qui structurent les mises en place des rapports à l’altérité. Une identité peut se construire dans un récit, pluriel, et, de plus, avec Françoise Collin, nous ferons glisser la notion chère à Paul Ricoeur “ d’identité narrative ” à celle “ d’altérité narrative ”. L’abord psychanalytique de l’identité ne peut prendre partie pour une le préjugé d’une identité comme substance de l’être. Et nous ne pouvons que refuser cette définitions “ substantielle ” d’identités ethnique atemporelles, logées, comme en un ombilic, dans une région inconsciente propre à chaque logique ethnique considérée.
S’il est indéniable que la figure de l’étranger suggère et éclaire les contours de l’altérité, il n’est guère exclu qu’une réponse objectivante en referme aussitôt l’accès. Nous tenons donc à une autre conception de l’origine que celle du hasard ou du site de naissance. Notre affaire n’est pas tant celle de l’autre dans sa diversité, mais celle d’une permanence de la condition humaine prise dans des positions de sujets repérables.
Passerelles méthodologiques
Soyons concrets, et tournés vers la pratique. Quels sont aujourd’hui les savoirs anthropologiques pertinents, utiles pour un clinicien dans le concret de sa pratique.
Sommes nous des observateurs sociaux du psychisme ? Avant de tenter de porter réponse à cette question intrépide, nous constaterons les champs d’évolution, au sein même de l’anthropologie, des modes d’observation des organisations subjectives.
Systématisant et hiérarchisant, les niveaux de l’enquête ethnographique, Lévi-Strauss a situé la distinction entre trois niveaux de traitement scientifique des faits rapportés. L’ethnographie c’est la collecte, l’ethnologie c’est la mise en forme de ces données dans l’analyse qui en sera faite et, enfin, l’anthropologie c’est la connaissance de l’homme en lui-même, autour des invariants de l’humanité. En fait l’enquête pose déjà des problèmes épistémologiques centraux, en particulier celui de la construction de l’objet et de la distance. À partir de ce moment là se pose aussi la question des logiques et des conditions de l’interprétation de ce qui est produit dans cette rencontre. Il faut sortir de la naïveté, il faut se rendre compte qu’un entretien ce n’est pas un discours, c’est un évènement. C’est l’évènement qu’il convient d’interpréter pour comprendre le discours. Il en est au moins autant de même avec des entretiens qui ont comme effet sinon comme objectif de non seulement de récolter des informations, mais de produire du changement.
Nous touchons là à un point de recoupement avec les démarches cliniques, dès lors qu’au plus près du terrain, nous tenons aussi à une épistémologie qui s’attache aux conditions de production du matériel et aux divers dispositifs.
C’est aussi la raison d’être de la clinique de s’interroger sur les dispositifs et les liens entre dispositifs et discours. Un travail épistémologique sur les conditions de production des discours et des paroles pourrait donc constituer un lieu possible de rencontre entre cliniciens et anthropologues. S’introduit ici le renouvellement très récent et tout à fait actuel du registre anthropologique. Il est de fait que des écrits qui font effet de relance dans les débats anthropologiques tous ultérieurs au déclin des modélisations structuralistes, et chacun à leur façon le consommant, repensent une articulation entre corps et origine. Si les anthropologues qui ont le plus marqué ce siècle -parmi eux E. Leach, M. Douglas et C. Lévi-Strauss- affirment que le corps et les pulsions ne sont pas des données fondamentale pour la construction de la culture et de la structure sociale, le nouveau rapport à la psychanalyse que manifestent positivement quelques anthropologues revient à reconnaître à la sexualité et à l’agression leur signification humaine et sociale. De même pour certains psychanalystes l’existence du psychisme et de l’éthique dans les sociétés dites « traditionnelles » est enfin reconnue. À une causalité psychique tribale ou ethnique fait place l’idée d’une singularité de la causalité psychique où que vive l’humain
De son côté l’anthropologie des mondes contemporains prend acte de ce que de nos jours, les facteurs anthropologiques et sociologiques ont changé. Les structures anthropologiques des généalogies ont été bouleversées, les lois de l’échange semblent de plus en plus s’abstraire -le don s’autonomisant par rapport à l’échange prend un tour sacrificiel, bref, la valeur immédiate qu’a l’acte posé ou la parole prononcée est de plus en plus floue pour des sujets et/ou leurs collectifs. Toutes les questions de la « construction de son monde par l’humain » sont ainsi réexaminées. D’une certaine manière la pensée même de la généalogie s’est déplacée, dans la modernité. C’est que la généalogie est moins recherche de l’origine que dialogue avec l’origine. Elle s’adresse non point tant à l’origine comme case départ, point absolu du commencement et de l’engendrement qu’à l’origine comme fiction et projet, équivocité salutaire. Du fait du refoulement de l’originaire, et de l’acte originaire (soit dans le « mythe scientifique » freudien : le parricide du Père de la horde), le point de départ de l’identité est un lieu vide de représentations, le sujet étant amené à relancer une certitude sur ce à quoi ressemble son être en produisant des traces, des actes de pensée. C’est, autrement dit le rapport à l’insu de l’origine qui est le progrès de l’œuvre de la civilisation dans la vie de l’esprit. Les récits identitaires, causals sont les traces, les traits écrits sur cet insu. Est perdue la coïncidence de soi à soi, coïncidence qui n’aura jamais existé. Dans les mondes contemporains, la fabrication comme la transmission de ces récits est rendue tributaire des violences et des heurts de culture.
Pour conclure et relancer
Si aucune homogénéité disciplinaire n’est à désirer ou à prétendre pour l’anthropologie et la psychanalyse, en revanche, il est possible de considérer que les dynamiques de méthode et la centration sur les processus de changements dans les discours et les mentalités, propre à l’anthropologie du contemporain, font de ces derniers des interlocuteurs indispensables au clinicien ; ainsi, nos interrogations qui portent par ailleurs sur les articulations et déhiscence entre espace psychique et espace urbain ne peuvent que rentrer en résonnance avec ce que Gérard Althabe, par exemple, expliquait à Monique Sélim de la modification des terrains et des problématiques de l’anthropologue, aujourd’hui. Je cire : “ Depuis une quinzaine d’années l’ethnologie s’est considérablement transformée, et l’un des indicateurs en est l’importance croissante des ethnologues travaillant sur la France… D’une manière plus générale, il semble qu’il faille sortir des découpages fondés sur des spécialisations selon les aires géographiques et culturelles pour élaborer des problématiques aptes à intervenir dans des terrains très différents…L’ethnologie est une, dans les immeubles HLM de la banlieue parisienne, dans un village de la côte orientale malgache, dans une entreprise argentine, ou à Saint-Quentin-en-Yvelines ”.
La transposition non critiquée d’une anthropologie populaire qui réduit la culture à de la psyché ou de la technique est, nous le mesurons ici, le piège réductionniste dans lequel se fourvoie la clinique. Ce piège, par ailleurs fort objet d’une demande sociale est ce à quoi contrevient l’Anthropologie du contemporain qui tient, dans la suite des innovations dues à G. Balandier et suivies par Althabe, à situer le sujet sur lequel elle travaille, comme étant ce sujet non substantiel, mais aux prises avec l’histoire et l’ensemble des violences politiques qui ont marqué les strates narratives et affectives de son rapport à l’identité et à l’altérité.
Nouveaux objets, nouvelles pratiques
La clinique alerte sur ces moments de décomposition/recomposition des montages identitaires. Les secousses que connaissent les protocoles usuels de fabriques et de montages des identités sont considérables. Elles mettent à la casse dans des usages parodiques, destructeurs ou auto-fondateurs, dans des inflations sacrificielles dans des errances, le rapport dogmatique de la vérité et de l’identité. Et c’est en effet une autre conséquence aussi des nouveaux passages entre anthropologie et psychanalyse, que de ramener la question du lien social d’une façon qui peut, de nouveau, avoir un sens par rapport à la clinique.
Nos étudiants, qui sont nos futurs collègues, effectuent des stages au cours desquelles ils rencontrent des réalités psychiques en prise avec le plus réel de notre société : le lien entre l’économique et la mort. Ce lien se resserre au vif du sujet lorsque ce dernier n’est plus tenu par l’éros de la colle sociale. Ce sont bien à des sujets dé-sidentifiés que les jeunes cliniciens ont affaire, ce sont de tels sujets qu’ils rencontrent, ce bien entendu, en dehors le plus souvent de ce qui reste de la psychiatrie. À côté de ce réel de la casse du sujet qui se montre sans rien demander de manifestement articulé à autrui, et que représente certains exilés, certains exclus, certains adolescents, surgit une autre forme de demande, qui a bonne presse. Cette demande davantage middle-class, soft, policée exige de l’institution universitaire de se muer en centre de formation à des psychothérapies tout venant, au sein desquelles, réduite à une technique comme une autre serait noyée la psychanalyse.
Je vois mal comment on pourrait disjoindre cette passe ambivalente qui traverse l’université : elle reçoit le plus souvent par ses stagiaires un “ bulletin de santé ” de la casse psychique contemporaine et, dans le même temps, veut, du moins pour certains de ses ténors se muer en Institut de Formation aux Psychothérapies. Quelle théorie de l’anthropos et du lien est ici en débat ? Je laisse la question ouverte…
Cette apparente contradiction, qui ne débouche pas sur une critique raisonnée de la mania psychothérapeutique si inflationniste, ne peut empêcher de voir que ce ne sont pas des discours cliniques et psychopathologiques se donnant comme horizon conceptuel de vagues souffrances psychiques ou “ dépressions ”, qui peuvent mobiliser un élément de réponse au défi que nous posent les nouvelles cliniques que découvrent nos stagiaires. Ce sont plus, bien plus, que des cliniques du Malaise, mais bel et bien des cliniques de la casse de ces sujets mis hors-discours et relégués dans l’ “ a-cité ” ;
Ces pathologies de l’identité (versus sujet) lorsque un sujet est réduit à de la coupure dessinent bien le visage de se sujet destitué sur lequel cliniciens et anthropologues ont sans doute à dire, sans omettre des fins de préconisation. L’urgence d’un tel dialogue éloigne de toute fausse connivence dans la coopération attendue de ces deux disciplines. Elle pourrait aussi éloigner des tentations culturalistes ou de cette façon un peu trop impérieuse de se réclamer d’un traitement tout “ psychothérapeutique ” hyper technicisé des béances subjectives contemporaines.


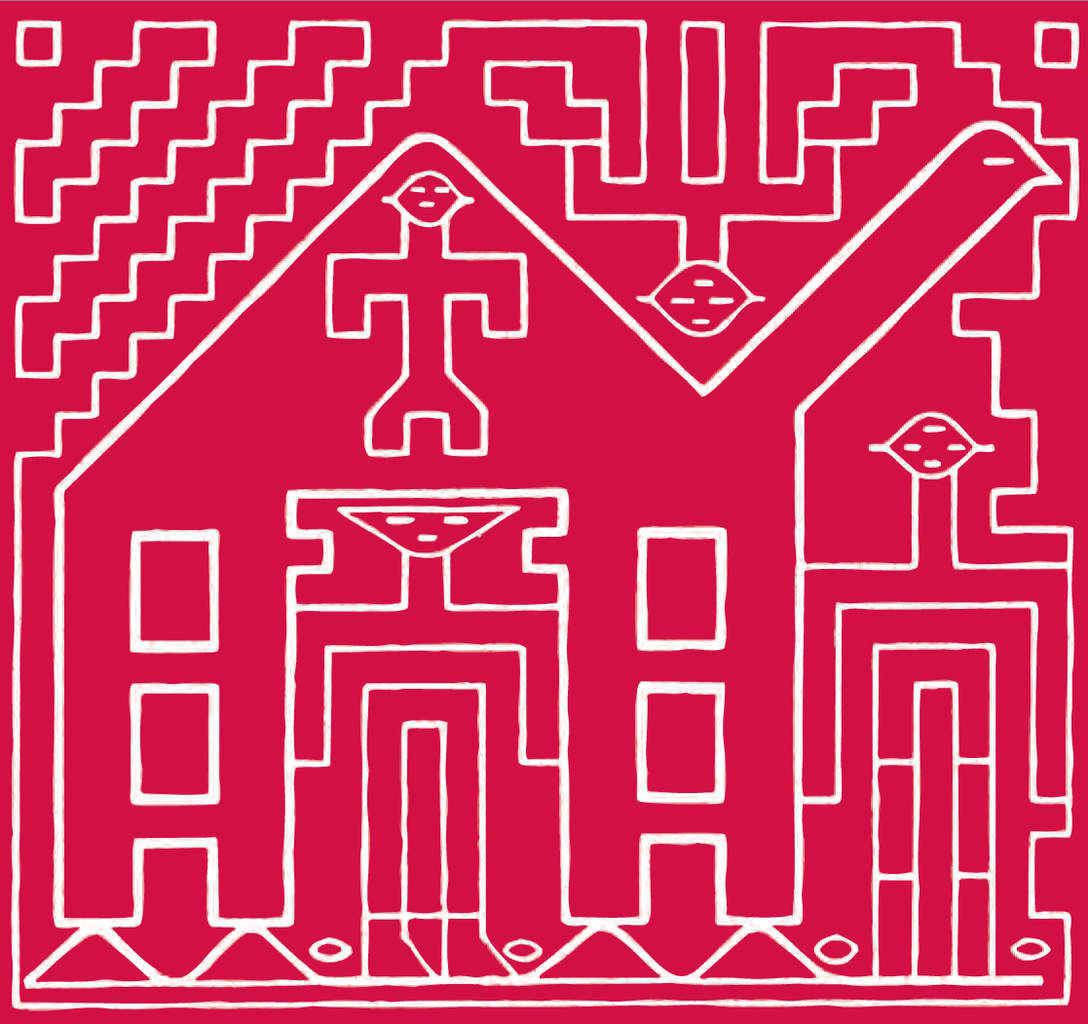
Laisser un commentaire