J’ai essayé en vain de trouver un titre pour ce texte.
Il me parle, et parle aussi probablement de vous. Je l‘ai commencé un beau jour, oui, il y a de beaux jours dans notre métier. Des jours, où on reçoit des bouquets de fleurs le matin, de courtes lettres ou des colliers de coquillages et de perles. Des jours, où on contemple le bus qui part à l’école, on accueille d’anciens « résidents » qui vont bien, et on accompagne d’autres à leur sortie définitive et départ vers d’autres chemins de la vie. Des jours, où l’entretien finit par le sentiment que quelque chose d’important a été dit, traversé…
Je l’ai continué un vendredi soir, après une semaine de fugues, de ruptures de lien, de passages à l’acte et de pertes ! Certains projets qui trébuchent, certains adolescents qui tombent dans l’addiction et l’errance. Tout cela en écoutant en boucle « Nesseyan » de la chanteuse libanaise Jahida Wahbe ! Elle dit : « la plus grande trahison est l’oubli » !
Je l’ai achevé, corrigé et commenté par des jours ordinaires, où il ne faisait ni beau, ni sombre. Sa majesté l’objectivité ou la neutralité !
Je le dédie à nos rêves, de début de carrière, de fin, ou de mi-chemin.
À ces rêves, nés, mort-nés, et avortés.
D’abord pourquoi ce thème? Certainement parce qu’il nous intéresse tous en tant que professionnels ayant la « responsabilité » d’œuvrer dans ce domaine, parce qu’il constitue une étape cruciale et alarmante dans une réalité sociale et individuelle complexe.
Pourquoi parler des institutions est-il important ? Parce que c’est l’espace de nos pratiques professionnelles, et pour nos sujets, il est beaucoup plus. Nous avons tendance à oublier que l’institution représente, pour eux, un espace de vie. Les professionnels qui se soucient de l’apport purement technique, oublie ce que représente et le vécu de cette traversée, omettent une dimension capitale.
D’ailleurs on entend souvent des professionnels témoigner d’une certaine prise de conscience lorsqu’eux-mêmes traversent des expériences similaires, de décès d’un proche, d’une maladie chronique, d’un placement d’un enfant de la famille en institution, d’une personne âgée en maison de retraite, d’une hospitalisation.
Et puis tous ces gens qui travaillent dans les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite, les asiles, les frontières de guerres, quelque chose en eux n’est-elle pas marquée par ces lieux ? Ne
luttent-elles pas pour ne pas en porter avec elles les traces tragiques, l’angoisse de mort, de solitude, d’anéantissement, de rejet, la honte de la dégradation de la condition humaine ?
Toutes ces questions méritent une réflexion collective et pluridisciplinaire.
Y a-t-il une meilleure façon de parler du placement institutionnel que d’introduire la parole du sujet ?
Y est une jeune fille qui a été placée au Centre à l’âge de 9 ans, livrée dès sa naissance à l’INPE, puis à une famille d’accueil de 3 à 9 ans… Comme cela se passe classiquement dans ces cas de figure, l’agir éclate, vols et mensonges, la famille s’épuise et l’abandon juridique s’ensuit, puis un placement est décidé. Des tentatives de remédiation familiale échouent, 3 ans de vie au centre où le lien est marqué par la quasi-totalité des troubles d’attachement « je vais tout faire pour que vous me rejetiez», mais où des réussites scolaires et des liens thérapeutiques se tissent aussi… Une insertion dans un CIJE clôture le parcours, la séparation bien que travaillée et préparée durant une année demeure douloureuse. Pour Y, un nouvel abandon est vécu, et ce n’est pas son choix. Y a dessiné un centre « rêvé », où elle revendique des choses toutes simples mais si cruciales aux yeux d’un enfant (tels que manger dans des assiettes et pas un plateau), des conditions qui ressemblent à celles d’une vie en famille et des liens moins froids.
Ne pas se soucier de ces lieux, désagréables à vivre, dégradés, sous prétexte que ces enfants ne seraient que de passage et qu’un jour ils devront rejoindre leur famille (laquelle ?), est pas d’une grande violence ?
Défendre la désinstitutionalisation, oui, certainement. En créant des familles d’accueil, avec indemnité, adaptées aux difficultés de la population, avec un protocole d’expertise, des dispositifs variés, un suivi réfléchi, des mesures d’intervention innovantes, etc.
Mais ceci n’exclut nullement la nécessité de réfléchir ces lieux de vie, pour les enfants qui auront nécessairement besoin d’un passage par le centre, avant de trouver des familles. La décision du retour à la famille est délicate, elle doit toujours être réfléchie par tous les intervenants.
Ces enfants sans familles, qui revendiquent que l’institution les accueille avec plus de chaleur, représentent un des nombreux cas de figure. Il y a aussi ceux qui investissent trop, massivement, l’institution avec tous les risques inhérents, mais aussi ceux qui sont incapables de l’investir.
S, une jeune adolescente de 16 ans, parents divorcés et famille recomposée où elle ne trouve nullement sa place, est orientée à plusieurs reprises vers le centre, son placement ne dure jamais plus qu’un mois, la fugue, raison de son placement et… de sa fin, se répète sans cesse.
Ces jeunes qui ne se reposent nulle part, qui déambulent d’un centre à un autre, qui ne supportent ni familles, ni institutions… Que cherchent-ils à nous communiquer ?
Quelle place pour ces enfants, « dits incasables » dans la littérature, dont on ne sait pas quoi faire et qui trainent d’une institution à une autre confrontant le personnel des réseaux d’accueil à un sentiment d’échec, et d’impuissance ?
Dans certains pays, on renonce à ce désir « idéal » de les « éduquer », on tolère qu’ils vivent dans la rue en créant des dispositifs adaptés afin de les protéger de toutes sortes d’exploitation sexuelle, économique, ou autre…
La question est complexe et nécessite certainement de réfléchir à une solution, je dirais à plusieurs : centres fermés, accompagnant de rue, etc.
Quand on parle de fugue, il faut aussi aborder les retours.
Postulons tout d’abord que certains professionnels vivent très mal le retour, comme un signe d’échec. Oui, il l’est parfois. Mais il est aussi un signe de vie, les oiseaux migrateurs, savent où aller, ainsi font nos enfants, c’est une chance d’avoir pour repères, le bureau de DPE, les couloirs de la brigade de mineurs, où la loge du gardien du centre où ils s’acharnent à nous revoir. Mettons-nous d’accord sur ce constat : nous rencontrons des jeunes en grande détresse qui mettent à mal nos connaissances, échouent au moment où on attend une gratification, nous mettent face à nos limites, nous pointent du doigt en nous accusant d’être des adultes « conventionnels » qui ne comprennent rien à leur drame en perpétuelle répétition ; des enfants qui sont dans un rapport de destruction, qui nous lancent d’emblée un défi, « vous ne pouvez rien ». Et la réponse ne sera certainement pas du coté de « nous pouvons ».
Que pouvons-nous faire ?
Sans invoquer de Dieu, sans désir de sauvetage, sans vouloir se substituer aux familles, ni vouloir les éliminer, sans idéologie du lien, sans excès d’institutionnalisation, comment ne pas tomber dans l’extrême, face à une violence sociétale et psychologique extrême ?
Et si on tente d’appeler les choses autrement ? Les récidives, décevantes, sont des chances… Elles prouvent que les enfants s’accrochent à la vie. Combien d’adolescents s’accrochent à leur projet et réussissent au bout de la 11ème tentative ?
Les fugues, certes alarmantes, sont des luttes, ils reviendront, ils nous l’ont déjà prouvé. Ils ont un lieu où revenir.
Le refus du centre, est un signe de bonne santé. Pourrions-nous vivre dans un quelconque ordre imposé dans la tempête de la jeunesse ?
L’acceptation du placement est à appréhender aussi comme un signe, refuser une famille pathologique n’est-il pas un signe de maturité ?
Le symptôme, même le plus bruyant, est l’empreinte d’un sujet, il extériorise sa souffrance sans bornes.
Je terminerai ce texte en vous parlant de A, adolescent de 16 ans qui a passé une année au centre, en donnant l’impression de ne pas faire grand-chose, à part une amourette affichée avec une adolescente qui irrite tant les adultes, des bagarres, et une insistance à venir à ses rendez-vous de soutien psychologique dans l’objectif de « m’embêter » avant de sortir à la fin et dire « je ne me sens pas mieux », puis revenir, et ainsi de suite.
Il quitte le centre, un peu brutalement. Plus de nouvelles de lui. Un jour je le rencontre à coté de l’hôpital militaire. Il se précipite vers moi. « Déstabilisée », je fixe du regard son bras plâtré. Il répond « j’ai pris une balle à Châambi ». Comme frappée par la foudre, je lui dis, assurément effrayée, « qu’est-ce que tu fais là-bas ? ». A ce moment là, son chef hiérarchique l’appelle, et il me répond « je suis soldat dans l’armée »… N’ayant pas le temps de trouver les mots, je lui dis brièvement de prendre soin de lui et lui signifie ma joie de le voir.
Il quitte rapidement et je réalise qu’il s’en était sorti et qu’il était heureux de me le montrer : l’hôpital, sa tenue, le bras, sa précipitation vers moi pour me montrer à quel point il était fier.
A m’a prouvé comme tant d’autres que quelque chose reste toujours à tenter…et que chacun tentera de le faire à sa manière. Même si le changement vient après de nombreuses d’années, grâce à la vie et un peu grâce à nous si nous savons rester patients.
Notre travail mené dans le champ social me rappelle l’histoire de cet homme qui plante des arbres dans le désert : planter et laisser le temps faire, sans prétention, sans illusion, sans duperie, sans attendre de voir fleurir des jardins, mais avec la conviction profonde que quelque chose reste possible. Il n’y a pas de recettes, mais inventer et réfléchir chaque lien.
Abri Stambouli, psychologue clinicienne, Centre de la protection sociale des enfants de Zahrouni. Avril 2016.


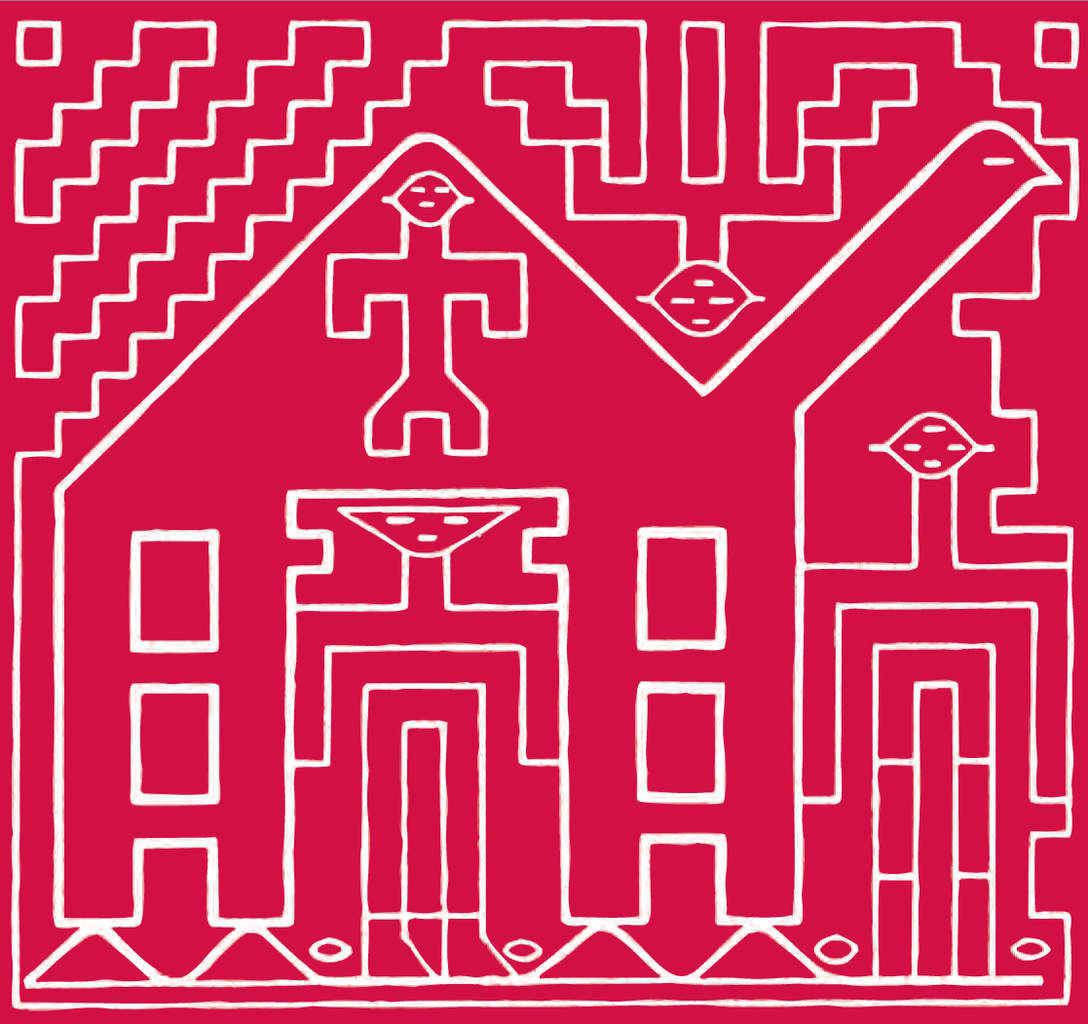
Laisser un commentaire